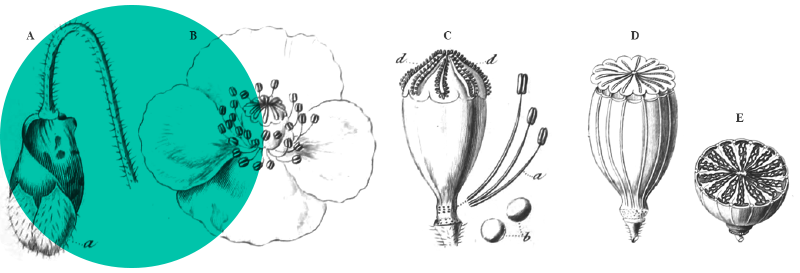La jacinthe d’Orient (Hyacinthus orientalis L.) entre tradition et marchandisation, flânerie parfumée dans les allées de l’histoire sur la piste d’une fine fleur
Title
The hyacinth of the East (Hyacinthus orientalis L.) between tradition and merchandising, perfumed stroll around the alleys of history on the trail of a délicate flower
Résumé
Cette contribution à l’étude ethnobotanique de la jacinthe d’Orient (Hyacinthus orientalis L.) a été déclenchée par une énigme que nous avons cherché à résoudre : il s’agissait pour nous de connaître la nature exacte d’un produit alimentaire mentionné sur le web sous le nom de « confit de jacinthe de Constantinople » de manière redondante mais sans pour autant que nous soit donnée la moindre indication sur sa composition et sur la source de l’information, alors même qu’il nous est décrit comme ayant été autrefois très prisé. Trouver une réponse à cette question nous a conduit à explorer les divers usages qui ont pu être faits de cette espèce, d’abord dans la tradition des pays d’où la plante est originaire, ensuite en Europe où elle fut introduite dans la deuxième moitié du xvie siècle, devenant rapidement, en raison de sa beauté et de son parfum, symbole d’élégance et de raffinement, une représentation valorisante qui fut beaucoup exploitée pour écouler divers produits dérivés censés posséder l’arôme, la saveur ou les propriétés médicinales prêtés à la plante. Pour nous, partir à la découverte de tous ces usages, qu’ils relèvent de la tradition orientale ou de l’innovation occidentale, ne fut en réalité qu’un prétexte pour mieux connaître la jacinthe d’Orient qui les inspira, en la suivant à la trace dans sa rapide diffusion en Europe à partir de son territoire d’origine. Ce fut pour nous, à tous les égards, un voyage passionnant.
Abstract
This contribution to the ethnobotanical study of the hyacinth (Hyacinthus orientalis L.) started with an enigma that we tried to solve: it was for us to know the exact nature of a food product mentioned on the web under the name of « confit de jacinthe de Constantinople », in a redundant way but without giving us the slightest indication of its composition and the source of the information, even though it is described to us as having previously been reputed. Finding an answer to this question led us to explore the various uses that may have been made of this species, first in the tradition of the countries from which the plant originated, then in Europe where it was introduced in the second half of the sixteenth century, quickly becoming – because of its beauty and perfume – a symbol of elegance and refinement, a rewarding representation that was greatly exploited to sell various derived products supposed to possess the aroma, flavor or medicinal properties lent to the plant. For us, embark on this discovery project of all these uses, whether they come from the eastern tradition or from western innovation, was in reality only a pretext to better know the hyacinth of the East which inspired them, by following it step by step in its rapid diffusion in Europe from its territory of origin. It was an exciting journey from all points of view.
Cette petite contribution à l’étude ethnobotanique de la jacinthe d’Orient (Hyacinthus orientalis L.), sous sa forme sauvage ou cultivée, et de quelques autres espèces végétales qui lui ont été assimilées, fait suite à un échange que nous avons eu sur un forum botanique à propos d’un produit alimentaire souvent mentionné sur le web sous le nom de « confit de jacinthe de Constantinople », un produit dont le nom revient de manière redondante mais sans pour autant que nous soit donnée la moindre indication sur la source de l’information, fusse-t-elle orale, recueillie au cours d’une enquête. Un peu comme si la multiplicité des mentions, recopiées peut-être les unes sur les autres, avait fini par donner à cette information un caractère de lieu commun, dispensé d’apport de preuve. En tout cas, notre discussion en ligne n’apporta rien de probant à ce sujet et toutes les recherches documentaires auxquelles nous avons procédé par la suite pour tenter d’en savoir plus sur ce produit sont restées vaines. Constat d’autant plus surprenant que ce produit est donné partout comme avoir été autrefois très à la mode, avant de disparaître totalement des circuits commerciaux, sans que l’on comprenne d’ailleurs pourquoi et à quelle date cette disparition eut lieu.
Que pouvait donc être ce confit et d’où lui venait son nom ? S’agissait-il d’un confit en saumure, au vinaigre, à l’huile, à la graisse animale ou au sucre ? Quelle partie de la plante était concernée par cette préparation ? L’appellation « confit de jacinthe de Constantinople » est-elle un descriptif condensé renseignant sur la nature du produit ou un nom commercial comportant une part d’exotisme destinée à susciter l’envie ? Comment faut-il décomposer cette appellation : désigne-t-elle un confit de jacinthe dont la ville de Constantinople se serait fait une spécialité ou un confit de la plante dénommée « jacinthe de Constantinople » et susceptible de provenir de n’importe quel lieu où cette plante existe ? Et quelle explication peut-on donner à sa soudaine disparition ?
Voilà le genre de questions qui nous sont venues immédiatement à l’esprit à partir du moment où nous avons tenté d’avancer dans la résolution de l’énigme que constituait cette appellation en suivant le seul fil conducteur en notre possession : la plante connue sous le nom de « jacinthe ».
Ne disposant d’aucun indice sérieux susceptible de nous mettre sur la voie, Il nous fallait donc envisager, les unes après les autres, toutes les possibilités, si nous voulions avoir quelque chance de parvenir, par construction méthodique d’hypothèses, à entrevoir un petit bout d’explication conduisant à lever le mystère, ou, au moins, une partie de celui-ci.
Mais commençons tout d’abord par une petite mise au point de botanique sur la plante qui est considérée aujourd’hui comme la jacinthe véritable – ainsi nommée, en référence au Ὑάκινθος (Yakinthos) des anciens Grecs – et sur toutes celles qui ont reçu elles aussi ce nom dans le langage courant pour différentes raisons que nous détaillerons plus loin.
1. La jacinthe en botanique
1.1. Jacinthe d’Orient (Hyacinthus orientalis) : forme sauvage et formes cultivées
Originaire de l’Asie occidentale (Turquie, région de Baghdad, région d’Alep, mont Liban, Palestine, Iran) où elle pousse sur les pentes caillouteuses[1], cette plante à bulbe, appartenant à la famille des Asparagaceae, fut introduite dès la deuxième moitié du xvie siècle en Europe méditerranéenne, en Hollande et en Grande-Bretagne, à partir de bulbes cédés vers 1562 par l’Orto Botanico de Padoue, premier jardin botanique européen à être créé[2] et probablement le premier à avoir reçu la plante en provenance de l’actuelle Turquie (Loudon, 1822). Peut-être même cette introduction se fit-elle en Grèce dès l’Antiquité, diverses mentions dans les textes grecs anciens pouvant être interprétées dans ce sens (Amigues, 1992). Dioscoride donne d’ailleurs du hyakinthos une description détaillée qui ne laisse aucun doute sur son identité : il s’agit bien de l’espèce Hyacinthus orientalis (Dioscoride, Materia medica, IV, 62). Rappelons cependant que Dioscoride était un Grec d’Anatolie, raison pour laquelle il aurait pu connaître la plante.
Ce qui est sûr c’est que la plante était bien cultivée en Europe au début du xviie siècle (Sweertius, 1612 ; Voorhelm 1752), c’est-à-dire à peu près en même temps que la tulipe. En France, les premiers bulbes furent cultivés par Vespasien Robin en 1608 dans le jardin que sa famille possédait à Paris (Lamy, 2015). De cultivée qu’elle était au départ, la jacinthe d’Orient s’est naturalisée en peu de temps partout en Europe où on la trouve de nos jours à l’état sauvage dans presque tous les milieux. Et la Chine, la Corée, le Japon, les États-Unis, le Canada, le Mexique, les Caraïbes et bien d’autres pays sont eux-mêmes devenus des terres d’adoption aussi bien pour la forme sauvage que pour les innombrables cultivars sortis des mains de l’homme.
Très rapidement en effet, les Hollandais s’intéressèrent à cette belle plante et s’adonnèrent à sa culture. Considérée comme une fleur de grand prix, elle fut l’objet de toutes les attentions de la part des horticulteurs qui s’attachèrent à en sélectionner des variétés à floraison plus abondante et à en diversifier l’offre. La forte demande commerciale pour cette belle fleur, devenue très à la mode, fit le reste : vers la fin du xviie siècle, plus de deux mille cultivars avaient déjà vu le jour, dont des variétés à fleurs doubles et d’autres à fleurs simples de toutes les couleurs (Doerflinger, 1989 ; Saint-Simon, 1768). Par leur aspect général, après plus de quatre siècles de sélection, ces variétés cultivées sont aujourd’hui très éloignées de la jacinthe sauvage qui a fourni le matériel génétique de départ.
La forme sauvage est une plante vivace à bulbe écailleux, pouvant atteindre 30 cm de hauteur. Ses feuilles, basales mais dirigées vers le haut, peu nombreuses (quatre à six), légèrement charnues, ont la forme de lanières allongées, canaliculées, de 5 à 15 mm de large. La hampe florale, assez épaisse, porte en grappe lâche deux à dix fleurs (rarement plus), parfumées, le plus souvent de couleur bleu pâle, parfois mauve, rose ou blanche. Leur périanthe est ventru à sa base avec des lobes étalés-recourbés plus courts que le tube. La plante fleurit au printemps (dès février dans son aire d’origine) durant trois à quatre semaines, embaumant l’air ambiant d’une odeur suave qui attire les abeilles (photo 1). Signalons ici que le genre Hyacinthus compte deux autres espèces – H. litwinowii Czerniak et H. transcapsicus Litv. – toutes deux présentes dans le nord-est de l’Iran et le sud du Turkménistan.
La jacinthe cultivée, issue d’un long et continu processus d’amélioration, est plus robuste et plus haute que la jacinthe sauvage, sa taille pouvant s’élever au-delà des 40 cm. Elle a surtout une hampe florale très fournie comportant jusqu’à une centaine de fleurs. Il est d’usage de faire une distinction entre différentes variétés bien que celles-ci n’appartiennent pas à des groupes botaniquement valides : selon son groupe, la jacinthe cultivée sera dite « de Hollande », « multiflore », « parisienne » ou « romaine », pour ne citer que les variétés les plus communes.
1.2. Autres jacinthes du langage commun
Le phytonyme « jacinthe » ne désigne toutefois pas toujours l’espèce Hyacinthus orientalis dans le parler de tout le monde et dans le lexique des fleuristes.
On a commencé par nommer « hyacinthe » le lis rouge (Lilium martagon L.), natif d’Europe, dont les bulbes étaient consommés[3]. Charles de L’Écluse lui-même établit cette équation dans une publication de 1557, avant que l’arrivée de la jacinthe d’Orient en Europe ne vienne tout changer (Morren, 1842).
À son tour, en 1753, Linné donna le nom Hyacinthus à deux espèces d’un genre dont l’un des représentants, rapporté de Constantinople[4], avait précédemment été nommé Muscari comosum (aujourd’hui Leopoldia comosa) par Charles de L’Écluse : ces deux dénominations linnéennes sont Hyacinthus muscari (aujourd’hui Muscari racemosum (L.) Medik.) et Hyacinthus racemosum (aujourd’hui Muscari neglectum Guss. ex Ten). Et ce n’est qu’en 1754 que le nom de genre Muscari fut rétabli par Philip Miller. Il avait été adopté par Charles de L’Écluse car c’était l’un des vernaculaires par lesquels la plante était connue à Constantinople, du grec médiéval μόσχαρι (moschari), une forme diminutive de grec byzantin μόσκος (moskos), la fleur ayant une odeur rappelant celle du musc[5].
Dans le lexique botanique commun, les vernaculaires « jacinthe » en français et « hyacinth »[6] en anglais ont toutefois continué à désigner les muscaris et même d’autres espèces à hampe florale du même type. Ces jacinthes par extension appartiennent en général à la famille des Asparagaceae. Dans le groupe des muscaris nous avons notamment Leopoldia comosa (L.) Parl. (synonyme : Muscari comosum (L.) Mill.) ; le Muscari à toupet, Tassel hyacinth des Anglo-Saxons, connu dans l’Antiquité sous le nom de bolbos ou bulbus ; Muscari armeniacum Baker, Muscari d’Arménie, Armenian grape hyacinth ; Muscari botryoides (L.) Mill. (synonyme : Hyacinthus botryoides L.), Muscari faux-botryde, Common grape hyacinth ; Muscari neglectum Guss. ex Ten. (synonyme : Muscari racemosum (L.) Medik.), Muscari à grappe, Starch grape hyacinth ; Muscari macrocarpum Sweet (synonyme : Muscari muscarimi Medik. var. flavum), Muscari jaune, Yellow grape hyacinth, à fleurs tubulaires jaunes, originaire de Grèce et de Turquie.
Le genre Muscari comprend une cinquantaine d’espèces natives d’Asie du Sud-Ouest, d’Europe méridionale et d’Afrique du Nord. À elle seule, la Turquie compte sur son territoire trente espèces dont vingt-cinq sont endémiques (Pinar et al., 2018). Certaines de ces espèces ont été introduites de nos jours dans tous les continents comme plantes ornementales et se sont naturalisées. Ce sont des plantes à bulbes recouverts d’une pelure brune, à feuilles basales, linéaires ou filiformes, du centre desquelles sort une hampe terminée par une grappe de fleurs de couleur variable (bleue, rose, jaune, blanche) et généralement odorantes.
Le phytonyme jacinthe a pu s’appliquer aussi chez les anciens Grecs à la Scille à deux feuilles (Scilla bifolia L.) comme l’a bien démontré Amigues (1992). C’est ce qui découle en tout cas du traité de Théophraste (VI, 8, 2) dans lequel une distinction est faite entre deux espèces hyakinthos, l’une cultivée, l’autre sauvage, l’espèce cultivée étant Hyacinthus orientalis L., l’espèce sauvage Scilla bifolia L. Cette dernière produit elle aussi de jolies fleurs bleues ou blanches délicatement parfumées, raison pour laquelle on lui donna le nom de « jacinthe sauvage », une mise en correspondance qui fut reprise par plusieurs auteurs médiévaux et qui passa ensuite dans le lexique botanique des populations européennes.
À la faveur de croyances liées à deux personnages de leur mythologie morts à la fleur de l’âge, Hyacinthe et Ajax, les Grecs ont également appliqué le nom de hyakinthos à certaines espèces végétales dont les fleurs semblaient porter des inscriptions figurant les initiales de leurs héros, ce qui a eu pour résultat de brouiller l’identité de la plante hyakinthos en faisant glisser le sens du mot au cours du temps vers diverses autres fleurs, y compris des fleurs mythiques. Le glaïeul des moissons (Gladiolus segetum Ker Gawl., syn. G. italicus Mill.) et le pied-d’alouette (Delphinium ajacis L. et D. consolida L.) ont ainsi été rangés au nombre des jacinthes dans quelques textes anciens. Selon Suzanne Amigues (1992), des fritillaires (Fritillaria sp.), des iris (Iris sp.) et l‘orchidée à quatre taches (Orchis quadripunctata Cirillo ex Ten.) ont fait partie eux aussi de ces jacinthes par extension.
D’autres espèces à belle floraison se sont vues attribuer ce même phytonyme, en raison soit – comme nous venons de le dire – d’une interprétation divergente quant à l’identité de l’espèce à fleur bleue à laquelle les auteurs de l’Antiquité ont assigné le mot yakinthos, soit d’une ressemblance plus ou moins affirmée avec la vraie jacinthe. Font partie de la deuxième catégorie deux espèces d’Amérique du Nord à fleurs bleues appelées localement Wild hyacinth : Dipterospermon capitatus (Benth.) Rydb. [= Dichelostemma capitatum (Benth.) Alph. Wood = Brodiaea capitata Benth.], et Triteleia laxa Benth. [= Brodiaea laxa Corrina], bien connues des Amérindiens qui en consommaient les cormes. Autre exemple : Bletilla striata Rchb. f., une orchidacée originaire de Chine, de Taiwan, du Tibet et du Japon, à laquelle on donna le nom d’« orchidée jacinthe » lors de son introduction en Europe. Nous trouvons aussi le vernaculaire anglais Desert hyacinth pour des espèces du genre Cistanche à fleurs jaunes ou violettes. Bellevalia romana (L.) Rchb. (syn. : Hyacinthus romanus L., Asparagaceae), une espèce méditerranéenne à fleurs blanches, est également appelée « jacinthe romaine », ce qui peut prêter à confusion avec la variété de jacinthe cultivée à fleurs blanches qui porte le même nom.
Cet embrouillamini, causé au départ en grande partie par l’interférence de la mythologie avec le lexique botanique des anciens Grecs, est largement à l’origine de la variabilité qui affecta ensuite le vernaculaire « jacinthe » héritier, dans toute sa complexité, du grec hyakinthos. Il faut ajouter à cela certaines libertés de langage que se sont données les fleuristes et les pépiniéristes qui ont traité sous le nom de « jacinthe » diverses plantes à fleurs ayant un air de famille avec l’original. Ainsi, on peut lire dans un contrat signé le 3 mars 1693 que le jardinier Joseph Gairand s’engage à fournir aux Maisons royales de Trianon, de Clagny, de Versailles, des Tuileries, de Saint-Germain et aux pépinières du Roule, chaque année, 65 000 oignons de fleurs dont, au mois de juillet, 12 000 jacinthes blanches (Hyacinthus orientalis L.), 20 000 narcisses de Constantinople (Narcissus tazetta L.), 1 000 « jacinthes del nivio » [Bellevalia romana (L.) Rchb.] et 2 000 jonquilles (Narcissus jonquilla L.) ; et, au mois de mars, 30 000 tubéreuses (Polianthes tuberosa L.), une espèce qui était alors appelée « jacinthe des Indes »[7] ou « hyacinthe orangère » (Lamy, 2015).
Dans les pays d’origine de la jacinthe d’Orient (Hyacinthus orientalis L.), la situation est à peu près identique. En Turquie, dans le Caucase, en Iran, en Iraq, en Syrie, au Liban et en Palestine, la plante porte le nom de sumbul, sombol, sunbul [8]. Mais dans ces pays aussi, ce vernaculaire – qui dérive d’un mot arabe signifiant « épi » tout en étant connoté « parfum »[9] – a été étendu à d’autres espèces des flores locales ayant la même allure générale que la jacinthe d’Orient, notamment Leopoldia comosa (L.) Parl. (sumbul), Muscari armeniacum Baker (sumbul, karga sumbulu), Galanthus fosteri Baker (sumbul), Gladiolus atroviolaceus Boiss. (sumbul), Scilla bifolia L. (orman sumbulu)[10].
Nous verrons plus loin que cet emploi plus ou moins polyvalent et extensif des mots « jacinthe » ou « hyacinth » dans les pays occidentaux et sumbul dans les nations de culture arabo-islamique pourra être à l’origine d’une certaine confusion quant à la nature exacte de produits transformés affichant ces noms.
2. Ethnobotanique de la jacinthe d’Orient
2.1. Les prémisses d’une recherche
La notoriété de la jacinthe d’Orient tient surtout à sa beauté et à son parfum ; c’est donc principalement en qualité de plante ornementale qu’elle fut largement diffusée sur tous les continents, devenant rapidement symbole d’élégance et de luxe. Quelques rares usages rituels, aromatiques, cosmétiques ou médicinaux existent cependant (ou ont existé) dans la tradition des pays d’où la plante est originaire, comme nous le verrons plus loin. Son image, qui fut longtemps associée à l’idée d’exotisme à l’orientale et de raffinement, a aussi été utilisée, spécialement en Europe, pour écouler divers produits censés posséder l’arôme, la saveur ou les propriétés médicinales prêtés à la plante.
L’Orient à l’époque, c’était d’abord l’empire ottoman et ses fastes. Il faut dire que cet empire – en tant que communauté de peuples, système politique et société – fut, pour l’Occident chrétien et ce jusqu’à la fin du xixe siècle, un objet de fascination qui nourrira la littérature, l’art et la mode, en créant un courant esthétique, l’orientalisme, construit autant sur des réalités levantines confirmées que sur des clichés fantasmés. Nous avons un exemple typique de cet engouement pour l’Orient, avec ses extravagances et ses mille et un produits exotiques, dans les représentations que l’Occident se fait du bazar arabe ou turc. Voici l’une d’entre elles, se rapportant au marché couvert d’Istanbul, telle qu’elle nous a été donnée par Edmondo De Amicis (1879) :
« Ici se trouvent les fameuses pastilles du Sérail qui parfument les baisers, les capsules de gomme odorante, que tirent du lentisque les robustes filles de Chios, pour l’envoyer raffermir les gencives des molles musulmanes ; les essences exquises de bergamote et de jasmin, et ces orgueilleuses essences de rose, renfermées dans des étuis de velours brodés d’or, et d’un prix à faire dresser les cheveux sur la tête. Ici l’on voit la pommade pour les sourcils, l’antimoine pour les yeux, le henné pour les ongles, les savons qui adoucissent la peau des belles Syriennes, les pâtes qui font tomber le duvet du visage des Circassiennes un peu trop masculines, les essences de cèdre et d’oranger, les sachets de musc, l’huile de santal, l’ambre gris, l’aloès pour parfumer les tasses et les pipes, une myriade de poudres, d’eaux et de pommades, portant des noms fantastiques et destinées à des usages indicibles, qui représentent chacune un caprice amoureux, un projet de séduction, un raffinement de volupté, et toutes ensemble répandent un parfum pénétrant et sensuel, qui vous fait voir comme en songe de grands yeux languissants et de petites mains caressantes, et entendre un murmure mystérieux de soupirs et de baisers… ».
Et voici ce que nous dit d’Istanbul/Constantinople, mais vue sous l’angle de la gastronomie, un autre connaisseur des traditions ottomanes, Gaston des Godins de Souhesmes (1896), qui fut journaliste résidant dans cette ville à la fin du xixe siècle et lui-même grand admirateur de l’art de vivre à l’orientale :
« Le vrai triomphe des cordons bleus du pays est assurément la confection des plats doux, des sirops, des confitures, de quelques menues confiseries et des pâtisseries de ménage, très préférables aux produits des meilleurs magasins. Je me souviens, notamment, de certaine confiture exquise, faite avec une espèce particulière de grosse fraise très savoureuse. Il convient de citer aussi les rabotes aux pommes, les flans aux cerises, qu’un pâtissier de profession dédaignerait de confectionner. Je ne parlerai que pour mémoire des sirops de maigriotte, de citron, d’orange ; et des pâtes aux fruits ; et des crèmes au moka, aux pistaches, à la vanille ; et des gâteaux aux amandes, au kirsch, au rhum, au marasquin ; et des petites meringues aux pétales de violette, au chocolat, à la fleur d’oranger ; et des nougats irréprochables ; et des soufflés de diverses sortes ; et des crêpes aux confitures, voire au fromage blanc ; et des rissoles ; et surtout de ces excellents börek, espèces de petits pâtés faits au beurre avec du hachis, du persil, ou simplement avec du fromage. Je n’aurai garde d’omettre les çörek, gâteaux confectionnés avec la farine de froment, du sucre, du beurre, des oeufs et ressemblant beaucoup aux « mouna » hispano-algériennes […]. Les magasins de pâtisserie sont assez nombreux à Constantinople, mais très modestes et de mérites divers […]. Les Turcs excellent dans l’art de fabriquer les « douceurs ». […]. Il me serait impossible de nommer ici tout ce que produisent les pâtissiers et confiseurs indigènes. Je signalerai cependant les pogaça, espèce de galettes grasses en pâte feuilletée, mais difficiles à avaler tant elles sentent le suif ; les baklava, gâteaux au miel ou au sucre, aux amandes ou aux noix, coupés en losanges ; le helva, pâte douce qui se prépare de plusieurs manières : avec du sucre ou du miel, du beurre et de la farine roussie, avec des noix, du sucre et du sapa (moût de raisin cuit), avec du miel, du sapa, de la farine et de l’huile de sésame ; le tavuk gögüsü, entremets composé de blanc de poitrine de poule pétri avec du lait ; le lokoum, sorte de gelée consistante, fine et fondante, aux sucs de fruits et mélangée d’amandes ou de pistaches ; les confitures, les compotes, les sucreries, et (ce qu’il y a de plus exquis) des sorbets au jus de fruits glacés dans la neige ».
Ces deux extraits, très représentatifs de la littérature orientaliste du xixe siècle, montrent combien l’Occident était fasciné par la grande métropole des rives du Bosphore, hissée dans l’imaginaire des gens au rang de capitale mondiale du bon goût et du luxe, dans tous ses excès, du superflu et de la démesure. Inclure le mot Constantinople dans une marque ou dans une dénomination commerciale était même devenu un label d’exotisme et de raffinement assurant d’office à un produit ainsi labellisé un accueil empressé de la part du public. Ce fut le cas d’étoffes, de broderies, de friandises, de miniatures, d’aromates et de bien d’autres d’objets, y compris des plantes. C’est ce que nous apprend, en tout cas, Morren (1842) qui raconte qu’on faisait passer comme lis blanc provenant de Constantinople, et connu là-bas sous le nom de sultan-zambach, une fleur qui n’était probablement qu’un iris de Germanie. La même assertion a été rapportée pour de vulgaires oignons à tunique noire qu’on a vendus comme de soi-disant bulbes de tulipes rares, dérobés secrètement à Constantinople. Selon Van Hulthem (cité in Morren, 1842), Dodoens aurait lui-même sciemment donné à l’espèce Lychnis chalcedonica L., pourtant originaire du Japon et de la Sibérie, le nom Flos constantinopolitanus. On connaît aussi un glaïeul dit « de Byzance », une appellation attribuée à l’espèce Gladiolus byzantinus Whistling Jack, originaire des régions méditerranéennes et pas spécialement de Byzance/Constantinople ; mais c’est là un procédé d’amplification bien connu et souvent employé pour promouvoir un objet nouveau.
L’un des produits affichant cette marque est justement ce fameux « confit de jacinthe de Constantinople » dont nous avons parlé en introduction à ce papier, mentionné partout mais sur lequel nous sommes à court d’informations tant ces mentions sont peu documentées. Nous avons donc cherché à en apprendre un peu plus sur les origines de cette spécialité alimentaire – si tant est qu’elle ait eu réellement cette qualité – autrement qu’en tentant de remonter vers une éventuelle source princeps d’où serait partie l’information, puisque, jusqu’à nouvel ordre, cette source est introuvable.
Et la première chose que nous avons souhaité connaître fut de savoir s’il existait, dans les pays d’origine, des traditions de consommation des jacinthes, vraies ou assimilées, d’une de leurs parties ou de produits en dérivant. C’est en effet chez les populations de ces pays où les jacinthes sont natives qu’il existe le plus de chances de trouver de pareils usages, vu qu’elles leur sont familières depuis longtemps et qu’ils en ont, de ce fait, une bonne connaissance.
2.2. Les jacinthes dans la tradition turque
Qu’en est-il tout d’abord en Turquie, le pays où la jacinthe d’Orient (Hyacinthus orientalis) est la plus répandue à l’état sauvage et où sont nées les premières variétés cultivées, parties de là à la conquête du monde ? En réalité, puisqu’il est question ici de tradition, il faudrait parler d’Empire ottoman plutôt que de Turquie, car en matière de patrimoine culturel c’est bien cet empire, fédérant sous son drapeau et sous sa loi plusieurs territoires, des Balkans au Proche Orient, du Caucase à l‘Afrique du Nord, qui a imprimé sa marque à l’art de vivre des populations passées sous son contrôle.
Notons tout d’abord qu’en dehors de quelques grandes villes ce vaste empire était principalement peuplé de communautés paysannes. Ces communautés, qui furent confrontées en maintes occasions au défi de la subsistance, connaissaient très bien la végétation de leurs territoires. Dans le domaine de la nutrition, ce savoir se reflétait dans l’infinie variété de fruits et graines de cueillette, de plantes potagères, de bulbes et tubercules sauvages, de gommes et sécrétions sucrées, de compléments alimentaires et d’amuse-gueule qui étaient consommés localement au cours des disettes ou même en période de suffisance alimentaire, par habitude ou par économie. C’est toujours le cas aujourd’hui en Turquie où Turcs, Kurdes, Arméniens font preuve d’un génie remarquable de la subsistance et d’une grande inventivité dans la manière d’apprêter, pour les rendre consommables, des aliments peu digestes à l’état brut.
On peut se faire une idée de l’importance et de la diversité des produits de collecte aujourd’hui utilisés en Turquie pour l’alimentation de subsistance ou d’appoint au travers des très nombreuses études ethnobotaniques publiées depuis une cinquantaine d’années sur ce thème. Voici les références des travaux que nous avons réussi à réunir et dont nous avons étudié le contenu : Lyle-Kalas (1974), Baser et al. (1986), Ertug-Yaras (1997), Ertug (2000), Ozbucak et al. (2006), Kargioğlu et al. (2008), Kocyigit & Ozhatay (2009), Buccini (2009), Kargioğlu et al. (2010), Yucel et al. (2010), Demirci & Ozhatay (2012), Dogan et al. (2013), Çakır (2017), Demirci & Eroğlu Ozkan (2017), Karaköse et al. (2018), Yeşil et al. (2019), Pieroni et al. (2019). Les auteurs de l’un de ces comptes-rendus d’enquête (Demirci & Eroğlu Ozkan, 2017), portant plus spécialement sur l’ethnobotanique des Hyacinthoidées de Turquie, ont eux-mêmes analysé 36 articles sur le sujet, parus avant le leur. C’est donc les données rapportées dans un ensemble de 52 publications que nous avons pu examiner.
Il ressort de cette prospection documentaire que plusieurs dizaines de bulbes, cormes, tubercules, plantes entières et feuilles de plantes sauvages sont consommées par les populations anatoliennes, ce qui montre bien que la tradition de complémentation alimentaire à l’aide de produits de cueillette est bien ancrée au sein de ces populations, préparées de génération en génération à bien distinguer ce qui est bon à manger et ce qui ne l’est pas. En faisant un focus spécial sur les espèces sauvages dont les parties souterraines et les fleurs sont consommées, on obtient la liste qui suit : les bulbes des espèces Galanthus fosteri Baker (Amaryllidaceae), Gladiolus atroviolaceus Boiss. (Iridaceae) et Leopoldia comosa (L.) Parl. (Asparagaceae), toutes trois localement nommées sumbul (comme pour la jacinthe d’Orient) ; les inflorescences de Muscari neglectum Guss. ex Ten. et de M. botryoides (L.) Mill. ; le bulbe d’Allium subhirsutum L., le bulbe de l’Iris galatica Siehe (Iridaceae ; navragaz) ; les tépales d’lris persica L. et d’I. reticulata M. Bieb. ; les cormes et les fleurs de Crocus ancyrensis (Herbert) Maw. (Iridaceae ; sijdem, kumizi sijdem) et de C. cancellatus subsp. damascenus (Herb.) B. Mathew (hursunnin, Iridaceae) ; le bulbe de Gagea villosa (M. Bieb.) Sweet (Liliaceae) ; le bulbe de Tulipa armena Boiss. ; les tépales parfumés de Tulipa sylvestris L. (Liliaceae) ; le bulbe de Scorzonera mollis M. Bieb subsp. szowitzii D.F. Chamb. ; le petit tubercule de Geocaryum cynapioides (Guss.) Engstrand (Apiaceae) ; les fleurs de Trigonella aurantiaca Boiss. (Fabaceae) et de Wiedemannia orientalis Fisch. & C.A. Mey. (Lamiaceae) ; les bulbes et hampes florales d’Ornithogalum narbonense L., O. montanum Cirillo, O. oligophyllum E.D. Clarke (Asparagaceae) ; les parties aériennes fleuries entières d’Ornithogalum armeniacum Baker, O. lanceolatum Labill., O. platyphyllum Boiss., O. sigmoideum Freyn & Sint. (Asparagaceae) ; le bulbe et la fleur de Bellevalia speciosa Woronow ex Grossh. (Asparagaceae) ; la fleur de Puchkinia scilloides Adams (Asparagaceae) ; la racine tubéreuse de Geranium tuberosum L. (Geraniaceae) ; la racine d’Echinophora tennuifolia L. (Apiaceae) ; les tubercules de différentes Orchidaceae dont Orchis tridentata Scop., Serapias vomeracea (Burm.) Briq. et Orchis anatolica Boiss. Les plus consommés sont les cormes et les fleurs des Crocus, qui sont considérés comme des mets délicats[11], les tubercules d’Orchidées dont on fait le salep, fécule et boisson bien connues, et les bulbes de diverses espèces du genre Muscari. Les bulbes de ces muscaris, notamment ceux de Leopoldia comosa (L.) Parl., sont très largement utilisés en Turquie en alimentation humaine[12]. Les inflorescences de cette dernière espèce, ainsi que celles de Muscari neglectum Guss. ex Ten. et de M. botryoides (L.) Mill. sont elles aussi récoltées en Turquie et utilisées pour leur arôme en art culinaire.
En milieu urbain, où la vie est moins ardue et où se sont installées les élites sociales venues des quatre coins de l’Empire, la situation est différente. Ici, l’opulence, la pompe et le goût de luxe des maîtres ont totalement réglé sur leurs exigences et sur leurs besoins les économies citadines. C’est à Constantinople plus spécialement, devenue Istanbul à partir de 1924[13], capitale de ce vaste empire et, de ce fait, carrefour de peuples et de civilisations, que l’on trouve le plus grand héritage gastronomique, issu du brassage ethnique et culturel entre Turcs, Kurdes, Arméniens, Grecs, Caucasiens, Albanais, Bosniaques, Arabes, juifs, etc. Pour s’en convaincre, il suffit de lire les récits que de nombreux voyageurs, célèbres ou moins connus, fascinés par ce qu’ils ont vu sur les rives du Bosphore, nous ont laissés de leurs visites des quartiers spécialisés et des bazars de la mégalopole.
Un auteur contemporain, Alain Servantie (2002), a eu la bonne idée de rassembler, dans une sorte d’anthologie à la gloire de Constantinople, quelques extraits significatifs de ces récits de voyage dont les plus anciens datent du Moyen Âge. Ces récits se recoupent avec les observations rapportées par la quasi-totalité des Européens qui ont vécu en Turquie à différentes époques. Leur dénominateur commun est l’émerveillement devant la profusion de choses à boire et à manger – des denrées, des mets, des boissons et des compositions, pour la plupart très raffinés – qu’offraient les commerces et les marchés de la métropole, où on les trouve encore de nos jours. Partout, des boutiquiers, des taverniers ambulants et des vendeurs à la sauvette exposent à la convoitise des passants ou proposent à la criée des viandes rôties, des fritures dans du kuyruk (graisse de queue de mouton de Karaman), des torchi (conserves de légumes frais dans du vinaigre), des noisettes caramélisées, des pistaches confites, des confitures, des sucreries de toutes sortes, des sirops, du raki, des liqueurs, des vins de divers fruits, du cidre, des crèmes glacées, des pilules et électuaires aphrodisiaques, de l’hydromel, du thé et du café, du kimiz (lait de jument fermenté), des cherbet aux fruits, aux fleurs et aux épices, des pâtes aux fruits, des citronnades et bien d’autres mignardises à la tentation desquelles il est bien difficile de résister. Dans les quartiers, des rues entières sont réservées aux confiseurs, aux marchands de lokoum et de gimblettes, aux limonadiers, aux pâtissiers, aux épiciers, aux fabricants de boza (bière d’orge ou de millet aux épices) et de salep, aux revendeurs spécialisés dans les confections coûteuses importées de Syrie[14] ou d’Inde. Et partout, dans ces grands marchés à gourmets où l’on peut trouver absolument tout ce qui est consommable, y compris du lait d’oiseau et des œufs de poisson, flotte dans l’air les senteurs entêtantes du musc, de l’ambre gris, de l’huile de santal, du bois d’agalloche, de la rose, de la violette, de la gomme mastic (Lady Craven, 1789 ; White, 1845-1846 ; des Godins de Souhesmes, 1891, 1894, 1896 ; Nicolas, 1982, 1991, 1992, 2009 ; Servantie, 2002).
Que ce soit donc à la campagne ou à la ville, les populations de l’actuelle Turquie, héritière de l’Empire ottoman et de sa civilisation, ont su tirer des ressources de la nature le maximum de ce qu’elles pouvaient leur offrir dans le domaine de l’alimentation et ont même donné à quelques produits tout à fait ordinaires une telle valeur ajoutée nutritionnelle et organoleptique, à force de les avoir travaillés, qu’ils en sont devenus des mets raffinés. C’est ce qui ressort très clairement de tous les comptes-rendus de travaux ethnologiques portant sur la Turquie.
Le plus étonnant, c’est que la jacinthe d’Orient n’apparaît à aucun moment dans ces comptes-rendus, ni comme ressource de subsistance dans les campagnes ni comme ingrédient ou additif alimentaire dans la cuisine bourgeoise des villes, pour quelque partie de la plante que ce soit. Des usages traditionnels de la plante ne sont signalés dans les travaux consultés qu’en parfumerie, sous la forme d’une huile de fleurs[15], ou comme espèce ornementale de jardins, fleur à bouquets ou motif de broderie.
On la voit aussi intervenir comme porte-bonheur et ex-voto appelant à une récolte prospère, à l’occasion de la fête de Hidrellez, célébrant l’arrivée du printemps. Au cours de cette fête, de belles fleurs[16], dont des jacinthes, sont cueillies par les jeunes filles des villages puis accrochées en couronnes aux portes des maisons. Elle est absente, en revanche, dans le rituel dit du Sifali otlar qui précède cette fête et qui consiste à cueillir 41 légumes et herbes sauvages potagères que l’on consommera crus ou cuits. Dans d’autres régions, cette cueillette sera remplacée par le mélange de sept plantes comestibles dont le nom commence par la lettre S. Mais là aussi la jacinthe est absente. À Istanbul et dans certaines grandes villes, en lieu et place de ces mélanges de plantes, on prépare un électuaire appelé Mesir macunu (litt. « électuaire de la kermesse ») ou Osmanli macunu ((litt. « électuaire des Osmanlis ») ou encore Padichah macunu (litt. « électuaire des padishas »), renfermant 41 plantes (Nicolas, 2009). Cette composition sucrée, dont on jetait au peuple des petits morceaux emballés dans du papier du haut des minarets, passait pour être une panacée prophylactique de tous les maux, un peu à la façon dont agissaient les thériaques des anciens Grecs. Aucune trace toutefois de la jacinthe dans ce mélange, contenant pourtant plusieurs autres plantes aromatiques.
En ville aussi, la jacinthe (sumbul, en turc) est donc tenue à l’écart des mélanges comestibles, combien même, sur le plan symbolique (langage des fleurs, rituels), son inflorescence occupe une grande place dans la culture locale. Interrogés, les nombreux amis stambouliotes que nous avons à Metz – une ville où la diaspora turque est importante – ne nous ont rien appris sur un éventuel emploi alimentaire qui serait fait de la jacinthe. Quel sens donner à une absence de mention à ce point systématique que l’absence devient, par défaut, présence de son contraire ? Simple méconnaissance de la plante ou argumentum a silentio ? Nous reviendrons plus loin sur la déduction que l’on peut tirer de ce constat.
2.3. La jacinthe dans la tradition iranienne
En Iran, dans les zones rurales, l’économie de subsistance ressemble beaucoup à ce que nous avons rapporté dans les lignes qui précédent pour la campagne anatolienne. Les recherches auxquelles nous avons procédé dans la littérature publiée montrent en effet que plusieurs espèces sauvages reçoivent en Iran les mêmes usages qu’en Turquie (Hooper & Field, 1937 ; Abbasi & Fritsch, 2008 ; Aberoumand, 2008 ; Farahmand & Farzad, 2015 ; Ghorbani et al., 2007 ; Amiri & Joharchi, 2016 ; Hosseini et al., 2021). Les récoltes qui reviennent le plus souvent portent sur les bulbes et cormes d’espèces des genres Allium, Ornithogalum, Crocus, Muscari, Tulipa et Fritillaria (F. imperialis L.), sur les tubercules des Orchis, sur les parties souterraines de Biarum straussii Engl. et de Polygonatum orientale Desf.
Au pays des Kurdes (d’Iran, de Turquie et d’Irak), ce sont surtout les bulbes et cormes des crocus (notamment Crocus cancellatus Herb. et C. biflorus Mill.), des tulipes (notamment Tulipa montana Lindl.), des ails sauvages (Allium divers) et des ornithogales (Ornthogalum divers) qui sont récoltés et consommés. Ici aussi, la jacinthe d’Orient n’apparaît dans aucun compte-rendu.
En revanche, dans les villes, qui ont recueilli et relativement bien conservé tout le raffinement et l’opulence que les brillantes civilisations achéménide, sassanide et arabo-islamique ont apportés au monde iranien, la jacinthe d’Orient n’est pas totalement absente de la tradition locale, même si la place qu’elle y occupe est plutôt discrète et, pour l’essentiel, cantonnée dans la sphère symbolique. En effet, dans les centres urbains iraniens, mais aussi dans les campagnes, quoique avec moins de faste, à l’occasion de la célébration de Norouz, le Nouvel An agraire qui se fête à l’équinoxe du printemps (c’est-à-dire entre le 20 et le 22 mars), on voit la jacinthe faire une timide apparition dans le rite des haft sîn (rite des « sept S ») comme figure allégorique d’un tableau symbolique représentant en quelque sorte ce qu’il y a d’immatériel et de transcendant dans notre vie opposé à ses aspects purement existentiels.
Pour les familles, l’observation de ce rituel consiste à dresser une table comportant sept éléments comestibles et sept autres non comestibles, chacun de ces quatorze éléments commençant par la lettre S et ayant une valeur symbolique qui lui est attachée en propre. Les sept éléments comestibles sont généralement les suivants : des germes de blé ou de lentille (Sabzeh) symbolisant la Renaissance, un pudding sucré (Samanu) symbolisant l’Abondance, le fruit de l’argousier (Senjed) symbolisant l’Amour, l’ail (Sîr) symbolisant la Médecine, la pomme (Sîb) symbolisant la Beauté et la Santé, le fruit du sumac (Somaq) symbolisant l’Éclat du soleil, le vinaigre (Serkeh) symbolisant la Patience et la Sagesse, vertus inhérentes à l’âge. Les éléments non comestibles traditionnellement présents sur cette table sont eux aussi au nombre de sept : des jacinthes (Sonbol), pour le Printemps, de l’argent pour la Prospérité, des œufs peints pour la Fertilité, un poisson rouge dans son bocal pour la Vie, un miroir avec un œuf posé au dessus pour le Reflet de la vie, des bougies pour le Feu et la Lumière et enfin un livre sacré (le Coran chez les musulmans, l’Avesta chez les zoroastriens ou encore un livre de l’un des grands poètes persans, selon la tradition de chaque famille) pour la Science. D’après les anciennes croyances antéislamiques, lorsque le poisson-taureau qui porte la Terre la fera passer d’une de ses cornes à l’autre, déclenchant le changement de saison, le tremblement provoqué par ce mouvement fera rouler l’œuf hors du miroir. C’est le signal attendu pour que les membres de la famille s’échangent embrassades et vœux de prospérité. Notons au passage que la jacinthe, dans cette célébration, est clairement classée au nombre des éléments non comestibles.
Dans les jours qui précèdent ces festivités, des gâteaux en forme de croissants, appelés ghotab (ou qottab) contenant amandes, noix, cardamome et cannelle, sont préparés par les femmes de la famille pour être dégustés lors des veillées. Comme la date à laquelle Norouz est célébrée correspond à la période de l’année où les jacinthes sont en pleine floraison, ces dernières sont utilisées pour parfumer les ghotab, les mojdeh ye bahar (macarons aux amandes), les baqlawa et les autres gâteaux préparés pour l’occasion. De simple figure symbolique qu’elle était jusque-là, la jacinthe a donc acquis un statut de matière aromatique par ce passage de la catégorie des représentations rituelles à la catégorie des nourritures rituelles.
Nos recherches documentaires ne nous ont rien appris sur le procédé employé par les cordons bleus d’Ispahan, de Chiraz et de Téhéran pour incorporer dans leurs créations pâtissières le parfum, très fragile, des fleurs de jacinthe, mais l’enquête que nous avons menée, directement ou par personne interposée, auprès de sources orales nous a apporté quelques éléments de réponse. Ces sources orales qui nous ont éclairé sont au nombre de deux : une dame originaire de Téhéran, qui a tenu autrefois un restaurant iranien et qui a bien voulu se soumettre au questionnement d’une amie parisienne, et une ex-enseignante, originaire d’Ispahan, que nous connaissons depuis longtemps, veuve et mère de famille, installée à Strasbourg avec ses enfants. Toutes deux avaient leurs propres réseaux de relations au sein de la communauté iranienne expatriée qu’elles ont à leur tour interrogée. Grâce à leurs témoignages à peu près concordants, ces deux personnes nous ont mis sur la voie. Selon elles, à Téhéran et à Ispahan, des fleurs de jacinthe fraîchement cueillies au printemps sont placées dans des bocaux fermés contenant des amandes blanchies, séchées et grossièrement concassées en y rajoutant chaque semaine une autre charge de fleurs et ce autant de fois que l’on pourra s’en procurer à l’état frais. Au bout de quelques semaines de contact intime, cette poudre grossière d’amande aura capté le parfum des fleurs introduites dans le bocal et pourra servir d’arôme de jacinthe pour toute préparation culinaire qui se prépare et se consomme à froid. Dans le cas de gâteaux, à leur sortie du four, cette poudre sera simplement dispersée à leur surface au dessus d’un badigeon de miel pour faciliter l’adhésion. Un deuxième procédé que nous ont décrit nos informatrices consiste à faire infuser des fleurs de jacinthe sur du bon beurre, de la graisse fine de queue de mouton, de l’huile de sésame ou de l’huile d’amandes douces placés dans un plat sous cloche, en renouvelant les fleurs plusieurs fois pour qu’une plus grande quantité de parfum vienne se concentrer sur le substrat lipidique. Ces matières grasses ainsi parfumées seront ensuite utilisées pour tartiner des crêpes ou pour aromatiser des laits, des yogourts, des sorbets gélifiés[17] et divers autres desserts froids. La préparation d’un macérat de fleurs dans du lait entier, le plus gras possible, avec lequel on fera des crèmes et du riz au lait, nous a également été rapportée pour Téhéran[18]. Quand c’est de l’huile de sésame ou de l’huile d’amandes douces qui a servi de lit aux fleurs, l’oléat obtenu est aussi utilisé par les femmes pour les soins du visage.
En fait, tous ces procédés traditionnels d’extraction à froid du parfum de la jacinthe ne sont rien d’autre qu’une application domestique de la technique de l’enfleurage[19]. Nous verrons plus loin qu’ils sont tout à fait pertinents car les fleurs de jacinthe, dont le principe odorant est thermolabile, ne doivent pas être soumises à la cuisson.
Dans cette fragilité du parfum de la jacinthe réside peut-être l’explication du peu d’usages qui est fait de cette fleur dans l’art culinaire au pays des mille et une douceurs. Les Iraniens excellent, en effet, plus encore que les Turcs, dans la fabrication de sucreries. Ils savent faire des confitures (murabbayat) de tout : aubergines, écorces de pastèque, carottes, coings, pétales de rose, violettes, fleurs de bigaradier, myrobolans et bien d’autres produits végétaux qu’ils apprêtent au sucre ou au miel. Avec le rhizome du Sceau de Salomon odorant (Polygonatum orientale Desf.), une espèce endémique du nord du pays, ils font une confiture spéciale, morrabay-e-shaghaghol, vendue sur les marchés à une certaine période de l’année. Avec la mangue (anbaj) ils préparent une conserve au miel (murabba banâj) très prisée des petits et des grands, au point que le mot anbijât est devenu synonyme de murabbayat. Les Iraniens sont aussi passés maîtres dans la fabrication de sirops (robb) – en particulier ceux de rose, de violette, de manne de chêne (dite aussi manne kurde), de réglisse, de vinaigre – et d’électuaires composés (juwârishun) associant parfois des dizaines d’épices et d’aromates. C’est dire tout le savoir-faire que les Iraniens ont acquis dans le domaine de la confiserie. Mais toutes ces spécialités au sucre ou au miel nécessitent pour leur préparation une cuisson au feu, opération qui ne convient pas aux fleurs de la jacinthe.
En dehors de ces quelques rares usages culinaires, cosmétiques et symboliques que nous venons de voir, en Iran la jacinthe n’est guère utilisée que comme espèce ornementale dans les jardins et comme plante à bouquets. À l’image de ce qui se fait en Turquie, elle est employée également dans l’industrie de la parfumerie, mais il ne s’agit plus alors d’usages traditionnels.
2.4. La jacinthe dans les livres arabes anciens
Nous avons également cherché à savoir si la jacinthe d’Orient avait trouvé une place quelconque dans les livres arabes anciens, en dehors des œuvres littéraires dans lesquelles son nom revient souvent, invoquée généralement comme un modèle de beauté et d’élégance, par exemple dans les poèmes d’Abu Nuwâs ou de Hafez, tous deux natifs de la Perse.
Traités de botanique et de pharmacie
Sous ûwâqintûs (arabisme du grec huakinthos), les auteurs arabes nous ont généralement laissé des tableaux de caractères plutôt succincts qui ouvrent le champ à diverses interprétations quant à l’identité des plantes décrites, les mêmes qui ont été proposées dans les traités occidentaux pour le huakinthos des anciens Grecs. Rien de surprenant à cela vu que c’est la Materia medica de Dioscoride qui a inspiré les uns et les autres pour la rédaction de cette monographie.
Al-Ghafiqi (xiie siècle), par exemple, décrit une plante de grande taille et à fleur rouge, nommée boheyla dans le langage vulgaire de l’Andalousie, une plante dont les bulbes, que l’on ramasse dans les vignobles et dans les champs de lin, sont comestibles et qui pourrait être une espèce du genre Gladiolus.
Abu-l-Khayr Al-Ichbilî (n° 2343), un auteur sévillan du xiie siècle, semble s’éloigner de l’opinion précédente puisqu’il nous décrit au nombre des lis et des iris une espèce dont les noms locaux sont khurram et sûsan habachî (litt. « lis d’Abyssinie ») et qui pourrait être une jacinthe spontanée en Espagne, Endymion hispanicus (Mill.) Chouard (= Scilla hispanica Mill. = Hyacinthoides hispanica (Mill.) Rothm.)[20]. En revanche, il ne consacre aucune monographie au ûwâqintûs.
Ibn Al-Baytar (xiiie siècle), qui a longtemps vécu à Damas et qui y est mort, donne pour ûwâqintûs (n° 191 et 1177) le synonyme hadaqî (litt. « qui ressemble à la pupille »), mais il ne nous en dit pas plus.
Al-Idrissi (xiie siècle) nous la présente comme une plante bien connue en Syrie où on la rencontre non loin du littoral. Quant à Dawud Al-Antaqi (xvie siècle), un auteur qui vécut et exerça longtemps à Antakya, aujourd’hui en Turquie, il nous rapporte pour la plante la même synonymie qu’Ibn Al-Baytar.
Les auteurs arabes ont donc donné des interprétations divergentes au huakinthos de Dioscoride dans lesquelles il nous est difficile de reconnaître de manière catégorique la jacinthe d’Orient.
Au Maroc, de nos jours, la jacinthe d’Orient, cultivée dans les jardins, est appelée yâqûtiya, du grec huakinthos, nom donné également à une pierre précieuse, la hyacinthe (Bellakhdar, 2020, n° 360). En Algérie et en Tunisie, qui furent pendant plusieurs siècles des dépendances de l’Empire ottoman, elle est connue sous le nom de sumbul, comme au Proche-Orient. Sa fleur, macérée dans un peu d’eau, est utilisée comme émollient pour traiter les affections de l’œil (Merad-Chiali, 1973).
Traités de cuisine
Sur cette thématique, pour le Moyen-Orient, quatre livres font autorité : le Kitâb al-Tabîkh (« Le Livre de cuisine ») d’Ibn Sayyar Al-Warraq, écrit au xe siècle ; le Kitâb al-Tabîkh (« Le Livre de cuisine ») de Muhammad Ben Al-Hasan Ben Muhamad Ben Al-Karim surnommé Al-Baghdadi, écrit en 1226 ; le Kitâb al-wusla ilâ l-habîb fi wasf al-tayyabât wa al-tîb (« Le livre du lien avec l’ami ou description des bons plats et des parfums »), un traité anonyme écrit en Syrie au xiiie siècle ; le Kanz al-fawa’id fi tanwi’ al-mawa’id (« Le trésor de conseils utiles pour la composition d’une table variée »), une compilation de recettes du xiiie ou xive siècle, produite en Égypte pendant la période mamelouk. Cette époque, spécialement le xiiie siècle, correspond à l’âge d’or des livres arabes de cuisine, autant d’ailleurs au Machreq qu’au Maghreb et en Espagne.
Le premier constat que l’on fait lorsqu’on étudie ces traités, c’est qu’ils consacrent une très grande place à ce qu’on désignerait aujourd’hui sous le nom de « cuisine bourgeoise », c’est-à-dire une cuisine généreuse qui ne lésine sur aucun moyen pour rendre les mets goûteux et appétissants, laissant au final une impression de luxe et d’opulence, un peu comme s’il s’agissait d’une cuisine de banquets et non de tous les jours. Or le banquet est un événement destiné à faire étalage du pouvoir ou de la richesse de celui qui reçoit, tout en étant un lieu de démonstration du savoir-vivre de l’hôte et des convives (nadîm, pluriel nudama) (Pitchon, 2020). L’abondance et le raffinement seront donc les grands marqueurs de cet art de la table qui est aussi, d’une certaine manière, une manifestation d’apparat et de puissance.
L’avantage, pour nous chercheurs, de cette cuisine de riches – qui n’est astreinte à aucun facteur limitant, tant du point de vue du coût des produits que de leur disponibilité – c’est qu’elle nous renseigne très bien sur la grande palette d’arômes, d’épices et de ressources alimentaires dont disposèrent très tôt les Arabes et que les Occidentaux à la même époque n’avaient pas. Elle reflète aussi la diversité des contributions culturelles apportées par les minorités dominées que les Arabes surent intégrer à leur civilisation. Nourri de cette pluralité, cet art culinaire a pu s’enrichir et se renouveler sans cesse en incorporant à son arsenal toutes les nouveautés reçues des régions où l’Islam avait étendu son influence.
Le Kitâb al-Tabîkh d’Ibn Sayyar Al-Warraq, traduit en anglais par Nawal Nasrallah (2007) sous le titre Annals of the caliph’s kitchens, est le plus ancien des quatre titres que nous avons cités et probablement celui qui a servi de modèle aux suivants. Plus de six cents recettes y sont décrites, classées de manière très méthodique et accompagnées de nombreux morceaux de poésie et anecdotes ayant un rapport avec le sujet traité.
Le Kitâb al-Tabîkh d’Al-Baghdâdî, traduit en anglais par Charles Perry (2005) sous le titre A Baghdad cookery book, n’est en réalité qu’un abrégé du précédent ouvrage paru trois siècles auparavant et duquel cent soixante recettes ont été extraites.
Le livre d’Al-Baghdâdî, qui nous donne une bonne idée de la gastronomie abbasside, a connu un succès remarquable, notamment en Turquie dès l’époque seljoukide, et sera encore plus largement diffusé après l’arrivée au pouvoir de leurs successeurs, les Ottomans. La grande cuisine qui prospéra sous cette dynastie doit en effet beaucoup à l’art culinaire abbasside. Plusieurs manuscrits du livre d’Al-Baghdâdî sont d’ailleurs conservés dans les bibliothèques d’Istanbul. Le texte arabe a été traduit en turc au xve siècle par Mehmed Ben Mahmoud Chirvânî, un érudit azéri qui a ajouté aux cent soixante recettes originales 82 recettes turques en usage à son époque. Cette version augmentée a été rééditée plusieurs fois en Turquie depuis la date de sa première parution et continue de l’être aujourd’hui.
Le Kitâb al-wusla, dont le texte arabe fut édité à Alep en 1986-1987, a été traduit en anglais par Charles Perry (2020) sous le titre Scents and flavors, a Syrian cookbook. Cet ouvrage, qui jouit toujours d’une grande popularité dans le monde arabe, comprend 635 recettes, dont un grand nombre en usage à Alep et Baghdad, et plusieurs autres arméniennes, grecques, kurdes, turkmènes, yeménites, égyptiennes, indiennes, maghrébines et même franques de Palestine. Le Kitâb al-wusla va au-delà d’un simple livre de recettes de cuisine : il propose également des consignes relatives à l’art de recevoir, au service de la table et à l’étiquette, ainsi que plusieurs recettes de parfums, d’eaux aromatiques et de savons[21].
Le Kanz al-fawa’id fi tanwi’ al-mawa’id, écrit en Égypte pendant la période mamelouk, semble être, quant à lui, une compilation de recettes du xive siècle. Il a été édité en arabe à Beyrouth et Stuttgart en 1993 et traduit en anglais par Nawal Nasrallah (2017) sous le titre Treasure trove of benefits and variety at the table: a fourteenth century Egyptian cookbook. Il contient 830 recettes de cuisine, dont des desserts et des boissons (mais aussi des produits cosmétiques), en usage dans différentes régions du Moyen-Orient et classées en vingt-trois chapitres.
Au total, ces traités réunissent à eux quatre plusieurs centaines de recettes, une partie importante de celles-ci étant consacrée aux douceurs, aux confiseries et aux préparations aromatiques (Perry, 2005, 2020 ; Nasrallah, 2007, 2017 ; Paiman, 2018). Les conserves (y compris les sirops) à base de miel ou de sucre (murabbayat), ou à base de vinaigre (murabba bi al-khall), les électuaires (juwarishnat), le plus souvent médicinaux, et les confits au sel ou à l’huile (murakabi) y sont beaucoup décrits. Cet art culinaire, qui a connu des heures brillantes sous les Ottomans, doit beaucoup à l’héritage abbasside qui fut lui-même en grande partie redevable de sa richesse, de sa diversité et de son raffinement à la tradition iranienne, comme en témoigne l’origine persane du nom de nombreuses recettes : sikbâj, zirbâj, faludâj, nârbâja, râshtâ, etc. (Wikipedia, Iranian cuisine).
Nous n’avons repéré dans aucun de ces livres un quelconque usage culinaire pour la jacinthe d’Orient – bulbes, tiges ou feuilles –, pas même pour les fleurs, combien même beaucoup de plantes à parfum, comme les roses, les violettes ou les boutons du bigaradier, ont trouvé leur place dans le registre des ressources et ingrédients de la somptueuse cuisine proche-orientale qui y est décrite. Ces livres se terminent tous par quelques pages consacrées aux soins hygiéniques auxquels les convives devaient se soumettre après un festin. Ces soins font appel à divers produits saponifères et aromatiques. Mais là aussi, à aucun moment la fleur de jacinthe ou l’un de ses dérivés ne sont cités.
Dans son Kitâb al-Tabîkh, Al-Baghdâdî décrit la manière de préparer une douceur appelée rutab muʽassal à base de dattes fourrées aux amandes, cuites dans du miel puis saupoudrées de sucre glace aromatisé au musc, au camphre et au sunbul. Beaucoup de traducteurs anglo-saxons ont cru fautivement que ce sunbul était la jacinthe d’Orient et l’ont donc rendu par hyacinth. En réalité, il s’agit ici du « nard de l’Himalaya » (Valeriana jatamansi Jones ; sunbul hindi ou sunbul al-asâfîr, encore appelé sunbul al-tîb, sunbul par abréviation). Ce nard était utilisé comme parfum mais également comme aromate culinaire. Al-Biruni précise d’ailleurs à ce sujet qu’en art culinaire le nard de l’Himalaya était l’un des constituants d’une composition aromatique contenant également du clou de girofle, de la même façon que l’ambre gris est parfois associé au musc. En cuisine, on pouvait utiliser aussi un autre sumbul, le « musc de racine » (musk rot), Ferula sumbul (Kauffm.) Hook. f., comme substitut du musc et conservateur d’aliments.
2.5. La jacinthe dans ses usages européens
En Occident, au début du xixe siècle, soit trois siècles environ après son introduction, la jacinthe d’Orient était devenue la plante d’ornement à la mode, en concurrence, pour la première place du palmarès, avec la tulipe qui avait elle-même suscité à partir du xviiie siècle une fièvre collective totalement inattendue. Cet engouement pour la jacinthe, en tant que fleur de jardin, durera trois ou quatre décennies puis s’estompera, mais son image positive, générée essentiellement par son élégance, son parfum et son exotisme, sera immédiatement récupérée par des esprits entreprenants pour écouler des spécialités pharmaceutiques, cosmétiques et alimentaires censés concentrer en elles les qualités intrinsèques de la plante. Devenue symbole de luxe et de raffinement, la jacinthe est ainsi passée des parterres du jardinier aux rayons et devantures de l’apothicaire, du confiseur et du parfumeur.
Il faut dire qu’à la même époque, avec le développement de la production sucrière outremer, les « confitures », comme on appelait à l’époque toutes les spécialités réalisées avec des aliments cuits dans du sirop ou du miel, avaient commencé à connaître un grand succès en Occident, notamment auprès des aristocrates et des bourgeois. Des manuels de fabrication de confitures furent même écrits et connurent un certain succès, à l’exemple du livre de Nostradamus, paru en 1555, réédité par la suite plusieurs fois, puis rapidement imité par d’autres auteurs : Benoist Rigaud & Jean Saugrain (1558), Nicolas de Bonnefons (1651, 1662), Olivier de Serres (1660), François Massaliot (1776), Tousey (1891), plus ou moins construits, pour certains d’entre eux, sur le modèle des livres arabes de cuisine[22].
On apprit à préparer des confitures de coings, de pêches, de poires, de pommes, d’agrumes et même de carottes et de navets. Dans les régions de production fruitière comme le Vaucluse en France, des unités artisanales de fabrication de conserves diverses s’établirent pour y exploiter les surplus. Au même moment, dans la région de Grasse, zone de culture de fleurs odoriférantes, la confiserie se développa dans le sillage de l’industrie de la distillation et du parfum, elle-même en essor constant à partir du xviie siècle (Baudequin Maisonneuve, 1996 ; Bourcier, 2017).
Dans ces unités, la technique de préparation du confit de pétales de rose, ramenée du Proche-Orient par les Croisés, fut adaptée aux fleurs cultivées dans la région, du moins à celles susceptibles d’être comestibles et d’apporter saveur et arôme au produit fini. Au nombre des fleurs cultivées qui servirent à cette fabrication, il y avait la lavande, la rose, le jasmin, la violette, l’œillet, le lilas, et probablement aussi la jacinthe d’Orient[23], ainsi que plusieurs autres espèces à floraison parfumée. Aux confitures et aux sirops de fruits, vinrent donc s’ajouter les confits de fleurs et les fleurs cristallisées (dites aussi « fleurs sucrées » et « fleurs poudrées ») qui seront perçues alors comme des friandises de luxe. Très vite, tirant parti de cette offre de qualité, la confiserie fit son entrée à la table des grands et devint même l’accessoire indispensable des fêtes et réceptions données par les cours européennes. En France, un confiseur audacieux, Joseph Nègre, ouvrit à Grasse, en 1818, une petite manufacture avec le projet de mettre à la portée de tous, à prix abordable, ce qu’il a appelé la « confiture de ménage » tout en développant une gamme de douceurs et de sucreries de grande classe.
À la même époque, à Vienne – devenue à partir du xviie siècle capitale européenne de la pâtisserie –, l’art du confisage suivit le même mouvement, influencé et soutenu en cela par la tradition ottomane qui s’exerçait alors très fortement dans les Balkans, jusqu’aux portes de l’Autriche, et par le savoir-faire italien, l’Italie ayant été pour l’Europe la toute première porte d’entrée du sucre et des produits venus de l’Orient.
Un autre haut lieu de la confiserie fut en effet l’Italie, notamment Gênes qui commença à se tailler une grande réputation dans ce domaine dès le xiiie siècle. Pour la République de Gênes, à cette époque, les sucreries et autres douceurs de fabrication locale ont même beaucoup participé à son activité diplomatique. C’est ce que révèlent les archives génoises qui décrivent avec force détails comment les comptoirs de la république en Crimée et sur le pourtour de la mer Noire ont maintes fois usé d’offrandes de confiseries pour asseoir leur position politique auprès des émirs de la région (Hryszko, 2018). De cette confiserie génoise, voici justement ce qu’en dit White en 1845 : « La capitale ligure a gardé le chic de la confection de violettes, roses et autres « pasta di zucchero » passées de mode chez nous ». Si certaines fabrications sont en effet devenues plus rares ou ont même disparu aujourd’hui, Gênes, mais aussi Naples, Venise, Milan sont toujours les gardiennes de cette belle tradition artisanale dont les racines en Italie sont très anciennes (Kociszewska, 2020 ; Hryszko, 2021).
Ce fut aussi le siècle où la mode des salons de thé se répandit en Europe. Aristocrates, bourgeois, artistes, écrivains et élégantes commencèrent à fréquenter ces lieux mondains où on leur servait, à l’heure du goûter, cafés, thés, liqueurs, sorbets, chocolats, gâteaux, confitures de fruits, confits de fleurs et toutes ces mignardises que les maîtres confiseurs s’ingénièrent à inventer pour fidéliser leur clientèle en les tenant par le péché de gourmandise.
Confrontés à cette nouvelle quête de plaisir, de frivolité et de luxe qui déferlait sur les grandes métropoles européennes, quelques confiseurs doués se firent rapidement un nom, certains d’entre eux devenant même fournisseurs attitrés des dynasties régnantes. À Paris, la pâtisserie Stoehrer, la plus ancienne de la ville (fondée en 1730), la confiserie Siraudin (ouverte en 1860), les maisons Terrier et La Caravane (créées toutes deux en 1865), entre autres enseignes à la mode, devinrent des adresses courues où se retrouvaient snobs et fins gourmets. À Grasse, la maison Joseph Nègre, déjà citée, acquit en quelques années une renommée mondiale pour l’excellence de ses confitures de fruits, ses confits de fleurs et ses fleurs cristallisées, une renommée qui se prolongera après 1949 sous la marque de son repreneur, la Confiserie Florian. À Strasbourg, Weise, devenu plus tard Achard-Weise, premier confiseur installé dans la cité avant de se transporter en 1870 à Paris après l’annexion prussienne de l’Alsace, façonna des sucreries qui étaient de véritables œuvres d’art. À Nice, le confiseur autrichien Rumpelmayer inaugura en 1860 un salon de thé très chic qui gagnera en célébrité lorsqu’il se démultipliera au début du xxe siècle sous le nom Angelina en plusieurs « boîtes » à délices, l’une d’entre elle située rue de Rivoli, à Paris. Toujours à Nice, la confiserie Maiffret (créée en 1885, disparue en 1981), qui débuta modestement, évolua très vite en lieu branché de rendez-vous pour les fines bouches de la ville et d’ailleurs. À Vichy, la maison Au Fidèle Berger (fondée en 1863) créa, sous la direction de Michel Coutière, toute une palette de sucreries sophistiquées qui firent le bonheur de sa clientèle et apportèrent un plus au renom de la cité thermale (Perrier-Robert, 1921).
À l’autre bout de l’Europe, Vienne, autre lieu d’excellence de l’horticulture florale et de l’industrie du luxe, était devenue à la même époque la capitale de la pâtisserie et de la confiserie, une célébrité qui donnera d’ailleurs naissance au mot « viennoiseries ». Plusieurs maîtres pâtissiers et confiseurs y avaient créé des enseignes prestigieuses dont la renommée avait atteint des villes aussi éloignées que Berlin, Varsovie et Moscou, notamment pour leurs somptueuses fleurs cristallisées. De nos jours, deux d’entre elles perpétuent brillamment cette vieille tradition viennoise : Der Demel (fondée en 1796) et Blühendes Konfekt Michael Diewald (de création plus récente). Les catalogues de ces maisons se limitent à donner quelques exemples de leurs spécialités florales (violette, rose, cerisier, myosotis, souci), mais précisent toutefois à l’intention de leurs clientèles que les maîtres confiseurs travaillant pour elles peuvent répondre à toutes les commandes.
En Italie, une même tradition d’excellence s’est maintenue à Gênes qui abrite aujourd’hui un établissement de confiserie célèbre, la Confetteria Pietro Romanengo, créé en 1780, l’un des plus anciens d’Europe. Et Naples n’est pas en reste : l’enseigne Confetti Crispo, fondée en 1890, a repris le savoir-faire talentueux des anciens confiseurs locaux. Idem pour Venise, Milan, Rome qui ont, elles aussi, quelques adresses mondialement connues.
Ce succès grandissant de la confiserie, destinée principalement à une clientèle aisée, dont le standing de vie s’est considérablement amélioré en moins d’un siècle, montre que le virage de l’ancienne économie « du strictement nécessaire » vers la société de consommation avait déjà commencé à cette époque. Le plaisir, l’amusement et la frivolité sont désormais recherchés ouvertement et l’opulence ne se cache plus. Afin de satisfaire les envies des classes sociales favorisées, avides de distractions et de nouveautés, de nombreux objets futiles furent mis sur le marché et vantés comme étant les indispensables accessoires du bonheur. S’alignant sur cette évolution des mœurs – la gourmandise n’étant plus considérée comme un péché –, les métiers de la pâtisserie et de la confiserie s’en sont donnés à cœur joie. Des aliments de misère ou habituellement dédaignés (glands, tomates immatures, fruits acides, etc.) devinrent, par la grâce du sucre et du talent des maîtres confiseurs, des friandises délicieuses. Des fleurs sans saveur et sans parfum furent transformées en assortiments variés et colorés d’amuse-bouche pour gourmets exigeants. L’importance est désormais dans l’apparence et non dans l’essentiel, surtout si cette apparence suggère le luxe et le raffinement.
Avant qu’il ne porte sur la jacinthe – sur laquelle il nous faut maintenant revenir après notre petite incursion dans l’histoire de la confiserie européenne –, ce phénomène de marchandisation d’un label de beauté et de raffinement associé à une fleur avait déjà concerné la tulipe. Charles de L’Écluse rapporte en effet qu’un pharmacien viennois de son époque confisait les bulbes de tulipe comme on le faisait des tubercules d’orchis, mais que ces tulipes ainsi préparées avaient bien meilleur goût (Morren, 1842). Idem pour les pétales des tulipes qui furent elles aussi proposées aux consommateurs sous la forme de diverses spécialités sucrées : confitures, sirops, etc.
Dans le cas de la jacinthe, le parfum inimitable de sa fleur lui valut une attention encore plus grande de la part des chasseurs d’aubaines et de nouveautés exotiques. De nos jours, on trouve partout, à l’image des « réclames » d’autrefois, des publicités pour des sirops de jacinthe, vantés comme particulièrement savoureux, bien que la fleur crue ou cuite n’ait aucun intérêt gustatif et que son parfum est détruit par la cuisson. À part l’idée de luxe qui lui est associée, on ne voit donc pas ce que la jacinthe aurait pu apporter à ce type de produits pour lesquels la présence de la fleur dans leurs compositions est censée être un gage d’excellence gastronomique. Des gelées et des confitures ont également été mises sur le marché, au sujet desquelles il est permis là aussi de se demander à quelle spécificité organoleptique de la plante renvoie la signature « à la fleur de jacinthe ». Certaines informations, non documentées, décrivent même des confits au miel ou au sucre, auxquels pourrait s’apparenter – s’il a réellement existé – ce fameux « confit de jacinthe de Constantinople » qui est partout mentionné comme un produit jadis très prisé mais sur la composition duquel aucune indication précise ne nous est donnée. Aujourd’hui, on propose aussi aux consommateurs des fleurs de jacinthe bio et fraîches[24], vendues en barquettes, pour la décoration des salades, des desserts et des pâtisseries ou pour des spécialités « faites maison ». Et rien n’est plus facile que de trouver sur le web des propositions de recettes, émanant le plus souvent de cordons bleus amateurs, décrivant, à l’usage des familles, les procédés à mettre en œuvre pour cristalliser les fleurs ou s’en servir en pâtisserie comme ingrédient décoratif ou aromatique (Perrier-Robert, 1921). Nous en trouvons un bon exemple dans le livre Gastronomie et plantes des jardins, du chef et chroniqueur gastronomique Daniel Zenner (2012) qui nous dit avoir réussi à produire des fleurs de jacinthe cristallisées sans toutefois nous préciser si celles-ci ont gardé leur arôme et leur couleur[25].
Pourtant, en dépit de ces foisonnantes publicités des temps modernes, à notre grande surprise, la jacinthe n’est jamais mentionnée de manière explicite dans les livres anciens et dans les catalogues des grands maîtres confiseurs contemporains, aussi bien pour la France que pour l’Autriche et l’Italie, une absence de mention que nous commenterons plus loin.
En revanche, dans le domaine de la thérapeutique, la jacinthe d’Orient est bien mentionnée dans quelques opus de pharmacie sans pour autant y occuper une grande place. Doerflinger (1989) rapporte que plusieurs pharmaciens du xviiie siècle ont inclus les bulbes de jacinthe dans leur arsenal de simples. Dans ces officines, la jacinthe était surnommée – pour une raison qui ne nous est pas expliquée – the scourge of the Arabs (« la malédiction des Arabes »). Son jus, mélangé à la moitié d’un verre de vin, était vendu comme un remède freinant la croissance de la barbe, une indication qui pourrait avoir été déduite de la propriété que reconnaissaient à la jacinthe les médecins arabes de retarder l’âge de puberté des garçons. Il s’agit cependant ici de bulbes et non de fleurs.
Le nom Hyacinthus apparaît aussi dans la formule de plusieurs confections décrites dans des textes occidentaux médiévaux et post-médiévaux dont certaines figuraient déjà dans les traités des médecins arabo-islamiques. Les confections (ou électuaires) sont des formes galéniques que l’on administre par voie orale dans les soins et dont le principe de fabrication est le suivant : des « simples »[26] (un ou plusieurs) réduits en poudre sont incorporés à du miel ou du sirop de sorte à obtenir une masse de consistance molle véhiculant les substances actives. L’hyacinthe des confections du haut Moyen Âge n’était cependant pas notre plante, la jacinthe d’Orient, mais l’hyacinthe minérale, souvent associée à d’autres pierres précieuses porphyrisées (saphir, rubis, topaze, émeraude, etc.), qui avaient la réputation de guérir tous les maux, y compris la peur, la jalousie, le chagrin d’amour, la mélancolie, etc. Ces confections étaient célèbres et très recherchées encore aux xvie et xviie siècles par ceux qui avaient les moyens de les acquérir. Elles sont toujours décrites au xixe siècle, avec leurs modes d’emploi, dans la Pharmacopée de Montpellier de Jean-Pierre Joseph Gay (1846). Cette hyacinthe minérale est généralement mentionnée dans ces formules anciennes sous l’appellation Hyacinthus. Un cas particulier est cependant à signaler : dans L’Antidotario napolitano, un formulaire annoté par Gioseppe Donzelli et datant de l’époque post-médiévale (1642), figurent deux préparations cordiales dites confections d’hyacinthe dont le constituant principal est reporté sous le nom « Hyacinthus orientalis » (sic). Ce cas particulier, nous le retrouvons aussi dans le De Febre maligna publié en 1651 par Pedro de Castro Bayonatis, un médecin exerçant à Vérone qui nous décrit trois compositions dites confection d’hyacinthe, les deux premières contenant la hyacinthe minérale et la troisième la confectio hyacinthina neapoli (« confection d’hyacinthe de Naples »), un simple désigné, là aussi, sous le nom de « Hyacinthus orientalis » (sic). S’agit-il ici de notre plante ou d’une variété asiatique de l’hyacinthe minérale ? Nous reviendrons plus loin, lors de notre discussion, sur l’interprétation de cette variation que nous avons relevée[27].
En parfumerie également, la jacinthe a donné lieu à quelques fabrications. Sandrine Teyssonneyre (2021) en a étudié le développement, du moins pour l’Europe, à partir des premières créations post-médiévales. Nous donnons ci-dessous, empruntées pour la plupart à cette spécialiste de la question, les dates qui nous instruisent le mieux sur l’évolution de cette activité.
En 1608, dans un livre intitulé De Distillatione libri IX qui reprend et développe le chapitre 10 de son œuvre principale Magia naturalis, le savant napolitain Giambattista della Porta décrit les techniques de production de plusieurs eaux florales dont une eau de narcisse et de jacinthe bleue, un livre qui vient à une époque où la culture des fleurs à parfum commence à se développer en Italie et dans le midi de la France et où la noblesse prend goût aux parfums. La jacinthe fut ensuite oubliée des créateurs en parfumerie et ne sera plus mentionnée comme ressource aromatique. Simon Barbe, qui fait le tour de ces ressources dans son livre Le parfumeur françois, paru à Lyon en 1693, n’y fait aucune allusion. Un siècle plus tard, se cachant derrière le pseudonyme M. Dejean, le distillateur parisien Antoine Hornot, dans son Traité des odeurs publié en 1764, redonne vie à la jacinthe en décrivant une pommade obtenue de ses fleurs par enfleurage, un procédé connu depuis l’Antiquité[28], et plusieurs recettes d’eaux florales contenant cette fleur. Ces eaux florales étaient obtenues en distillant au bain-marie les liquides obtenus en laissant macérer des mélanges de fleurs pilées dans de l’esprit de vin ou de l’eau-de-vie. En 1801, Jean-Louis Fargeon, dans son ouvrage L’Art du parfumeur, reparlera de la jacinthe, brièvement mentionnée comme constituant de quelques eaux aromatiques. Nous en apprenons un peu plus dans Le Parfumeur impérial de C.-F. Bertrand, publié en 1809, un manuel très complet sur les préparations odorantes du xixe siècle : son auteur y décrit une pommade obtenue par enfleurage d’un mélange de fleurs de jacinthe, d’oranger, de réséda, de tubéreuse, de jasmin et de cassie puis renforcée par addition d’essence d’ambre. Sont mentionnés également dans cet ouvrage une poudre de jacinthe sur amidon, un macérat de jacinthe obtenue par enfleurage sur huile de ben et une « eau de jacinthe » combinant une alcoolature de fleur, de l’esprit de vin et de l’eau, mélange dans lequel ont été dilués de l’extrait de benjoin ou de baume de Tolu, de l’essence d’ambre et de l’essence de musc. Cette « eau de jacinthe » sera reprise en 1825 par Marie Armande Jeanne Gacon-Dufour dans son Manuel du parfumeur. Et, à peu près à la même époque, dans The Druggist’s general receipt book (paru en 1853), le Britannique Henri Beasley publiait la formule d’une eau de toilette baptisée « eau d’élégance » contenant esprit de jacinthe, esprit de jasmin, esprit de styrax, esprit d’anis étoilé, teinture de baume de Tolu, teinture de vanille.
Toutes ces vieilles formules sont aujourd’hui dépassées, l’arrivée des techniques modernes d’extraction par solvants organiques ayant fait émerger de nouvelles gammes de parfums et d’eaux de toilette plus dans l’air du temps. Par extraction des fleurs de jacinthe au solvant, on obtient une concrète d’où sera tiré dans un deuxième temps un absolu d’une très grande puissance aromatique. Mais les rendements sont extrêmement faibles : pour obtenir un kilogramme de concrète, il faudra traiter 200 kg de fleurs, soit un rendement de 0,20%, et ce kilogramme de concrète ne donnera que 140 g d’absolu. Selon Guenther (1949), dans The Essential Oils, au cours de la décennie 1920-1930, quatre-vingt tonnes de jacinthe par an étaient traitées dans la région de Grasse et autant aux Pays-Bas ; puis cette production a commencé à décliner pour disparaître complètement dans les années 1950, remplacée par des huiles essentielles reconstituées[29], beaucoup moins coûteuses à produire. Désormais les parfumeurs n’utiliseront plus que ces dernières, plus facilement dosables et reproductibles et donc beaucoup plus maniables dans la création de compositions complexes.
Sous cette forme, à un titre ou à un autre, comme note florale de cœur ou de tête, comme senteur dominante ou d’accompagnement, la jacinthe d’Orient conquit rapidement l’industrie du parfum. Et, les uns après les autres, les grands parfumeurs européens finirent par céder à la divine senteur de sa fleur : Roger & Gallet, Coty et Lubin avec Jacinthe, en 1910, 1914 et 1922 ; Caron avec Jacinthe Précieuse en 1911 ; Chanel avec No 22 lancé en 1922, No 19 en 1970 et Cristalle en 1993 ; Worth avec Je Reviens en 1932 ; Guerlain avec Pois de Senteur en 1911, Chant d’Arômes en 1962, Chamade en 1969 et Nahéma en 1979 ; Yves Saint-Laurent avec Y en 1964 ; Guy Laroche avec Fidji en1966 ; Lancôme avec Climat en 1967 ; Givenchy avec Givenchy III en 1970 ; Hermès avec Amazone en 1974 et 24, Faubourg en 1995 ; Penhaligon’s avec Bluebell en 1978 ; Van Cleef & Arpels avec First en 1978 ; Jean-Louis Scherrer avec son Eau de toilette femme en 1979 ; Coudray avec Jacinthe et Rose en 1983 ; Annick Goutal avec Heure Exquise en 1984 ; Cartier avec Must II en 1993, Carat en 2018 et Allégresse en 2021 ; Serge Lutens avec Bas de soie en 2010 ; Tom Ford avec Ombre de Hyacinth en 2012 ; Jean Patou avec Chaldée en 2013 ; Thierry Mugler avec Supra Floral en 2014 ; Shalini avec Iris Lumière en 2020.
Au final, si nous devions résumer ce chapitre, en Europe – en dehors des pratiques habituelles d’opportunisme commercial et de quelques usages marginaux, qui sont plus le fait de cordons bleus amateurs que de professionnels
–, la fleur de la jacinthe d’Orient ne semble pas avoir reçu en confiserie, en dépit de son parfum enchanteur et de sa belle couleur, le même accueil que celui qui fut réservé, par exemple, à la rose et à la violette. En pharmacie, la situation est peu différente car, si quelques mentions d’usage ont pu être relevées, l’apparition de la jacinthe dans l’arsenal thérapeutique reste quand même timide et sujette à discussion. En revanche, dans le domaine de la parfumerie, la valorisation des propriétés aromatiques de la fleur a été entamée relativement tôt, aboutissant au début à des compositions peu sophistiqués (huiles parfumées, onguents, poudres odorantes, etc.), une production qui a toutefois évolué vers des produits plus élaborés en même temps que progressaient d’une part la demande en produits de luxe, d’autre part les connaissances sur la chimie des substances aromatiques et les technologies mises en œuvre pour leur extraction.
3. Chimie et toxicité de la jacinthe d’Orient
Totalement exclue de leur registre alimentaire[30] – comme nous venons de le voir – par les populations des pays d’où elle est originaire, la jacinthe d’Orient est aussi très peu présente dans leurs pharmacopées traditionnelles. En dehors de l’indication de la feuille et de la hampe florale en décoction buvable dans le traitement des maladies de la prostate, nous n’avons trouvé d’emplois pour cette espèce (plante entière, feuille, hampe florale et bulbe) que comme cicatrisant, hémostatique et anti-hémorroïdaire, en applications externes (Demirci & Eroğlu Ozkan, 2017 ; Karaman & Kocabas, 2001 ; Altundağ & Ozturk, 2011 ; Saklani et al., 2020). Cette pauvreté d’usages pourrait signifier que les populations locales se méfient de cette plante, comme nous en avons déjà eu une première indication dans le non-recours à ses bulbes en économie locale de subsistance. La même situation prévaut dans les anciens traités arabes de médecine qui ne consacrent que peu de place à leur ûwâqintûs en reproduisant, par ailleurs, la même ambiguïté que celle qui ressort des textes grecs.
Cette méfiance vis-à-vis de la plante a toutes les raisons d’exister, car son bulbe a la réputation au Proche-Orient de rendre malades ceux qui le mangent, un constat que viennent confirmer nos connaissances actuelles sur la chimie de la jacinthe d’Orient[31].
Toutes les parties de la plante, notamment le bulbe, contiennent en effet des alcaloïdes pipéridiniques toxiques, dont l’a-homonojirimycine (= dihydroxyméthyl-dihydroxypipéridine), l’alcaloïde dominant, accompagné de la lycorine. Ces alcaloïdes ne sont pas détruits par la cuisson. Le bulbe renferme également de l’acide oxalique et une lectine qui participent eux aussi à la toxicité de la plante. La fleur, quant à elle, contient plusieurs anthocyanes (dont certains sont acylés) avec peu de différences entre la fleur sauvage et la fleur cultivée. L’huile essentielle de la forme sauvage contient de l’alcool phényléthylique (composant dominant, de 48 à 55%), de l’alcool cinnamique (23 à 29%), du 1-hepten-3-ol, de l’alcool benzylique. Celle obtenue à partir des variétés cultivées est constituée des mêmes composants avec une teneur plus élevée en alcool phényléthylique, pouvant atteindre 75%. C’est cet alcool phényléthylique (présent également dans la rose) que l’on retrouve concentré dans l’absolu, accompagné de vanilline, d’eugénol, des alcools benzylique et cinnamique, d’esters, d’acétates et d’éthers phénoliques (Guenther, 1949 ; Descotes, 1996 : Asano et al., 1998 ; Knight, 2007 ; Mulholland et al., 2013).
Lorsque le bulbe est ingéré en petites quantités, les effets toxiques peuvent passer inaperçus ou se manifester discrètement. Mais dès que cette consommation devient conséquente, les symptômes de l’intoxication apparaissent : démangeaisons au niveau de la peau, vomissements, salivation excessive, diarrhées, crampes de l’estomac, parfois asthme et irritation au niveau du nez chez les personnes sensibles. Par contact, la sève et les bulbes provoquent des dermatites (Murray, Toxic plants, in Descotes, 1996).
4. Synthèse des données et discussion
Comme nous venons de le voir tout au long des lignes qui précèdent, ni les enquêtes ethnobotaniques ni les recherches dans les livres anciens de recettes culinaires ne permettent de mettre en évidence dans la tradition des populations du Proche-Orient – qui constitue l’aire d’où la jacinthe d’Orient (Hyacinthus orientalis) est originaire – un quelconque usage alimentaire de cette espèce, à l’exception des huiles et des pommades parfumées obtenues par enfleurage et que les familles utilisent comme support d’arôme. De ce fait – une fois ces données issues de la tradition en notre possession – les confitures, confits, fleurs cristallisées, conserves et sirops de jacinthe, proposés en Europe aux consommateurs, en surfant sur l’image positive de la plante, nous ont posé un problème. S’agit-il, en l’occurrence, de produits inspirés par des pratiques authentiques observées quelque part dans les pays d’origine de la plante, pratiques qui nous auraient échappé, ou de créations purement commerciales exploitant une opportunité de gain facile, un peu comme ces gadgets portés par une mode ou une campagne publicitaire et devenus « tendance » le court temps que dure un engouement de foule, avant de passer à la trappe comme c’est le devenir de tous les objets futiles ?
Sur cette question, après avoir examiné des dizaines de travaux, consulté par échange épistolaire des historiens spécialistes (correspondances : R. Hryszko, 2021 ; L. Plouvier, 1921), analysé et confronté entre elles toutes les données recueillies, la conviction à laquelle nous sommes parvenu est que la jacinthe d’Orient – pour toutes les spécialités confisières affichant son nom comme un label de qualité et de luxe – ne fut qu’un argument de vente, une affiche de racolage, exploitant le prestige d’une fleur et la fascination qu’exerça l’Orient sur les Européens jusqu’au début du xxe siècle. En effet, si la plante avait possédé une quelconque valeur alimentaire ou simplement condimentaire, fusse-t-elle minime, forcément cette qualité intrinsèque n’aurait pas échappé au génie de la ressource et à la perspicacité des populations partageant avec elle le même espace de vie et rompues aux comportements de subsistance du fait d’une longue expérience de précarité et de débrouille.
Par chance, ces populations – qu’elles soient de Turquie ou d’Iran, les plus familières avec la jacinthe – ont suscité la curiosité des voyageurs et des orientalistes depuis déjà plusieurs siècles, ce qui a donné naissance à une abondante littérature sur leurs mœurs et sur leurs pratiques. De plus, depuis une cinquantaine d’années, les territoires de ces communautés ont été arpentés en tous sens par des chercheurs et ont fait l’objet de nombreuses enquêtes anthropologiques, notamment en ethnobotanique, aujourd’hui facilement accessibles sur le web et dans les banques de données.
Or l’examen analytique de cette copieuse documentation ne révèle rien qui s’accorde avec les usages qui sont faits de la fleur en Europe. Dans les villes comme dans les campagnes, le même constat peut être fait. Pour Constantinople/Istanbul, la grande métropole aux mille et une spécialités culinaires, aucun des récits de voyage que nous avons étudiés ne décrit la jacinthe d’Orient comme ressource ou ingrédient alimentaire. Pas davantage de mentions de cet ordre dans les guides de voyage, pourtant toujours friands de curiosités à faire connaître à leurs lecteurs. Nos recherches sur le web et nos enquêtes auprès de restaurateurs et de cordons bleus familiaux turcs et iraniens furent elles aussi peu concluantes et ne nous apportèrent rien de ce que nous cherchions en dehors d’usages marginaux des fleurs fraîches de jacinthe pour parfumer et égayer de couleurs vives des hors d’œuvre de crudités. Quelques procédés traditionnels de captage du parfum des fleurs à des fins pâtissières nous furent aussi décrits, et c’est tout[32]. La tradition populaire orientale a donc clairement exclu la jacinthe d’Orient du registre des ressources nutritionnelles.
Les études de chimie et de toxicologie ont d’ailleurs apporté la preuve de la toxicité de la plante, notamment de son bulbe et de ses feuilles, ce qui vient confirmer la justesse du jugement populaire à son endroit. De plus, de par sa composition chimique, le parfum et le pigment des fleurs ne résistent pas à la chaleur. Nous en avons nous-même fait l’expérience en essayant de préparer à chaud un sirop de jacinthe. Notre préparation ne se distingua par aucun arôme, aucune saveur particulière autres que celle du sucre ajouté et les fleurs avaient perdu leur belle couleur. Cuites simplement dans de l’eau, expérience que nous avons également faite, les fleurs ne se sont pas révélées meilleures au goût et leur parfum avait disparu. C’est d’ailleurs en raison de cette fragilité du parfum et de la couleur des fleurs de jacinthe que les Iraniens, qui excellent dans la fabrication de douceurs et de sucreries, n’en font pas des confiseries (confitures, fleurs cristallisées, sirops, etc.) nécessitant une cuisson.
En revanche, en Europe, dès le xvie siècle, un simple dénommé « Hyacinthus orientalis » apparaît dans la composition de certaines spécialités. Les premières à voir le jour furent les spécialités d’apothicaires, notamment un certain nombre de confections, dont l’une, dite « confection d’hyacinthe », constituée à l’origine d’hyacinthe minérale, semble avoir évolué au cours du temps, puisque nous la retrouvons dans certains formulaires du xviie siècle décrite non plus avec « Hyacinthus » comme constituant principal, mais avec « Hyacinthis orientalis » (sic). S’agit-il, dans ce cas de figure, de notre plante ou d’une variété asiatique de l’hyacinthe minérale ? Une annotation de Giuseppe Donzelli dans l’Antidotario napolitano nous a permis d’apporter une réponse : la « Hyacinthis orientalis » dont il est question dans la deuxième composition est de la même nature minérale que la « Hyacinthus » de la formule classique. L’hyacinthe d’Orient est simplement une variété rouge grenat provenant de l’Asie du Sud-Est, alors que l’hyacinthe ordinaire est de couleur jaune légèrement rougeâtre.
La « Hyacinthis orientalis » de cette confection napolitaine post-médiévale n’est donc pas la jacinthe plante, tout juste débarquée en Europe. Au xviie siècle, nombreux étaient encore les remèdes anciens prescrits dans les soins. L’hyacinthe minérale était réputée assurer une puissante protection contre la maladie et le poison, apporter sagesse et tempérance et attirer sur soi honneurs et bonne fortune. Cette solide réputation l’avait en quelque sorte aidée à se maintenir dans le panel des bons remèdes légués par les médecins grecs et arabes.
Mais ce siècle fut aussi celui où l’obsolescence commençait à atteindre plusieurs préparations galéniques datant de l’Antiquité, trop complexes, trop coûteuses et ne correspondant plus aux conceptions médicales du moment. Parmi ces préparations venaient en premier les thériaques et les confections, notamment celles qui contenaient des pierres précieuses, de la poudre d’or, de l’argent ou des perles, car la croyance au pouvoir extraordinaire de ces minéraux et métaux, au demeurant très onéreux, s’était entretemps émoussée. Concernée par cette évolution des mentalités, la confection d’hyacinthe fut d’abord simplifiée par élimination progressive des pierres précieuses qui en étaient les principaux constituants, à l’exception de l’hyacinthe parce que c’est elle qui donnait son nom à la préparation. On a un bon exemple de ces formules « allégées » dans le traité de François-Louis Maistral (1770). Par la suite, les mœurs et les croyances progressant avec le temps, l’hyacinthe fut elle-même écartée de la formule bien que la confection continuât à porter son nom afin que son prestige demeurât intact (Dictionnaire de l’Académie française, 1932). On est ainsi passé petit à petit d’un remède empirique à un remède symbolique. À partir de ce moment, divers ingrédients nouveaux, actifs ou pas, ont pu venir prendre la place de l’hyacinthe. Nous n’en avons pas la preuve, mais il n’est pas exclu qu’au nombre de ces ingrédients de substitution la jacinthe-plante ait pu être l’un des plus indiqués, favorisé en cela par son homonymie avec le produit d’origine.
Cette remise en question de quelques anciennes croyances en matière de remèdes et de soins a coïncidé avec l’arrivée sur le marché européen, désormais en quantités plus grandes, du sucre et de ses dérivés (mélasses, cassonnades, candis, etc.) produits dans les colonies[33]. En conséquence de cette nouvelle abondance, les sucreries changèrent de statut : en déclin depuis quelque temps en tant que remèdes, elles connurent un nouveau départ en qualité de friandises, accessoires de table, objets de plaisir. Les juleps médicamenteux devinrent sirops de bien-être, les pastilles adoucissantes devinrent dragées, les confections et les électuaires devinrent pâtes sucrées, confits et confitures. C’est ce que nous dit aussi Liliane Plouvier (1993) dans l’étude qu’elle a consacrée à ce type de formes galéniques : « [à cette époque], les electuaria delectabilia ressemblent davantage à des confiseries qu’à des médicaments. C’est la raison pour laquelle on les retrouve également dans les livres de cuisine médiévaux, quoique sous d’autres dénominations […]. À cheval entre la confiserie et la pharmacie, [ils] quittent progressivement I’officine pour I’office. Clusius n’en retient que quelques-uns, dont le diacydonium, rangé non parmi les « electuaria« , mais parmi les « conserva » et « condita » (ces confections d’origine arabe — murrabayat, qui font I’objet du chapitre IV de l’Antidotarium Mesuae — sont en fait des fruits confits) ». Assertion confirmée par Rafal Hryszko, qui a travaillé sur l’histoire de la confiserie sud-méditerranéenne et avec lequel nous avons beaucoup échangé : « Les confiseries des xve et xvie siècles sont une version simplifiée des médicaments sucrés de la pharmacie musulmane et de celle qui s’est développée en Europe latine. Dans ce cas, les anciens ingrédients médicinaux avaient moins d’importance. Le goût et l’apparence comptaient plus » (Rafał Hryszko, correspondance personnelle du 14 septembre 2021). Les premiers marchands de douceurs en Italie, notamment à Venise, furent d’ailleurs les apothicaires de la ville.
Au prix de cette métamorphose, les anciennes confections, du moins les plus célèbres d’entre elles, purent se maintenir et continuèrent de bénéficier du grand crédit qu’elles avaient acquis au Moyen Âge. Ce contexte favorable est, à notre avis, celui qui permet d’interpréter au mieux le succès qu’eurent à l’époque postmédiévale les premières confitures et confits de fruits, fleurs et autres matières végétales.
Et c’est peut-être à la lumière du glissement qui s’est ainsi opéré de médicaments vers des articles de plaisir que le débat sur le fameux « confit de jacinthe de Constantinople », mentionné partout comme ayant été autrefois très prisé, doit être repris. En nous basant sur l’ensemble des données que nous avons recueillies sur les usages de la jacinthe d’Orient, nous avançons deux hypothèses totalement opposées : i) ce produit a réellement existé, ii) les mentions rapportant l’existence de ce produit ne sont que des assertions fautives, colportées d’auteur à auteur, sans vérification préalable.
Commençons par examiner la première situation, celle où ce produit a réellement existé. Mais alors, dans cette hypothèse, de quoi ce confit serait-il fait ? Ce ne pouvait être un produit importé tout fait du Levant[34], puisque la tradition orientale ne le connaît pas ; et il ne pouvait être préparé à partir de bulbes de jacinthe, puisque ceux-ci sont toxiques. Restent les fleurs. Mais dans ce cas quel pourrait être l’intérêt de ce confit s’il ne garde pas leur parfum ? Notre avis est que ce produit, en incorporant la fleur dans sa composition, exploitait tout simplement, à des fins lucratives, l’image positive de la jacinthe autant que celle de Constantinople en surfant sur la « jacinthomania » et sur l’orientalisme qui s’étaient saisis des milieux branchés de l’époque. Pour nous, ce fameux confit n’a donc été, dans le meilleur des cas, qu’un avatar de l’ancienne confection de hyacinthe minérale, que c’est un faux-produit, sans aucune activité ou propriété sauf d’être sucré, un faux-produit qu’on a fait passer du rayon de la thérapeutique au rayon de la confiserie pour le faire perdurer mais qui a fini lui aussi, à un moment donné, dans le discrédit parce qu’il n’apportait rien de vraiment nouveau sur le plan organoleptique. Cette fin rapide et sans gloire pourrait expliquer qu’aucune source sérieuse n’en a fait état. Car, aujourd’hui comme hier, on peut tromper le consommateur un temps, mais jamais très longtemps. Nous déduisons aussi de tout ce qui précède que ce « confit de jacinthe de Constantinople » est une pure création européenne, sans lien aucun avec les pays d’origine de la plante. Nous n’avons pas trouvé, en tout cas, ni dans la littérature consultée ni auprès des sources orales interrogées, de recettes locales de confitures, de fleurs cristallisées ou de sirops de jacinthe qui seraient véritablement propres aux populations du Proche-Orient et constitutifs de leur patrimoine culinaire. Tout ceci dans l’hypothèse où le produit ainsi nommé a réellement existé – ce dont nous ne sommes plus très sûr, arrivé aux termes de notre étude – et en supposant qu’il ne s’agissait tout simplement pas d’une mystification commerciale faisant passer une plante pour une autre ou d’une dénomination impropre pour une spécialité bien connue en Italie et en Grèce, le confit vinaigré de bulbes de Leopoldia comosa (le muscari à toupet), une espèce souvent dénommée « jacinthe » dans le langage commun[35].
La seconde hypothèse serait que l’on est en présence d’une simple erreur de dénomination dont aurait été responsable, à l’origine, un premier auteur, mais qui fut reprise ultérieurement par d’autres auteurs se copiant les uns les autres, sans vérification à la source, au point de devenir un lieu commun consacré comme information vraie par les nombreuses mentions qui en ont fait état. Il est possible que l’on ait voulu désigner au départ, avec cet intitulé, une confection à Hyacinthus orientalis, prise fautivement pour la jacinthe cultivée et non pour ce qu’elle est réellement, une variété rouge grenat de l’hyacinthe minérale. D’autres leçons fautives, attribuables à la non-spécificité du vernaculaire jacinthe, peuvent avoir été à l’origine de cette dénomination impropre. Nous sommes dans ce cas en présence d’une simple erreur malencontreuse d’auteur qui aurait été ensuite colportée de livre en livre, et rien d’autre.
Ne sont également que des nouveautés nées en Europe toutes les recettes que l’on voit fleurir sur la toile ou dans des livres de cuisine décrivant des modes de préparation de sirops, de confitures et de diverses sucreries possédant le parfum des fleurs de jacinthe. Nous doutons d’ailleurs du caractère authentique de leur parfum dans la mesure où toutes ces préparations se font à chaud[36] ; ou alors l’aromatisation annoncée n’a été obtenue qu’avec des arômes artificiels ajoutés après cuisson et non avec des fleurs[37]. Ce type d’arôme se prête mieux en effet aux fabrications en grandes séries.
Selon nous, toutes ces variations commerciales autour de la fleur de jacinthe relèvent de la catégorie de produits dits « produits concept » qui exploitent davantage l’image d’une matière que la matière elle-même. Nous en avons des tonnes d’exemples en cosmétique avec tous ces shampoings, lotions et laits corporels aux plantes qui contiennent de faibles quantités d’extraits végétaux afin de suggérer que leur activité leur est entièrement due et, en même temps, faire vrai, mais qui ne doivent en réalité leurs propriétés qu’à des additifs de synthèse incorporés dans la formule. Ces produits fonctionnent comme des métaphores : on leur crée un contexte, par le biais duquel l’esprit du consommateur se détache du sens premier du mot et du réel et se dirige là où on veut le mener. Finalement, le seul domaine, hors l’horticulture, où l’apport de la jacinthe d’Orient a été d’un bénéfice indiscutable, c’est celui de la parfumerie[38].
Telle est la petite histoire de la jacinthe d’Orient et de son introduction en Europe, racontée du point de vue d’un ethnobotaniste animé au départ par une simple motivation de curieux, peu satisfait qu’un produit censé être dérivé de cette plante ait pu construire sa légende et sa réputation sur une identité usurpée. Rares, en effet, en dehors de la tulipe, et peut-être du mimosa et du camélia, sont les fleurs qui ont provoqué un tel engouement lors de leur arrivée dans une nouvelle terre d’adoption. Commercialement parlant, cette mode, qui fut plus qu’une frivolité passagère puisqu’elle s’installa durablement, devenant même un phénomène de société, eut un succès à ce point notable qu’elle suscita auprès d’esprits entreprenants des idées de gains faciles. Il est peu commun en effet qu’un simple oignon de fleur ait pu s’échanger « contre huit veaux de la plus belle race » et ait eu sa cote sur les marchés financiers comme le serait une marchandise précieuse. Des produits dérivés furent donc imaginés, créés et mis sur le marché : diverses confiseries, des remèdes et des produits cosmétiques, spécialement conçus pour des achats impulsifs. Leur cycle de vie ne fut pas très long, pas plus que ne l’est généralement celui des objets futiles, car ils ne proposèrent aucune vraie innovation, n’apportèrent aucune typicité véritable, n’offrirent aucune distraction durable, répondant à la demande d’exotisme des consommateurs, mais le souvenir de ces produits dérivés survécut quelque temps à leur disparition, « l’effet jacinthe » ayant été l’unique cause de cette survivance.
Pour nous, partir à la découverte de ce type de produits ne fut en réalité qu’un prétexte pour mieux connaître la jacinthe d’Orient qui inspira leur création, en la suivant pas à pas dans son expansion à travers le monde à partir de son territoire d’origine. Ce fut pour nous, à tous les égards, un voyage passionnant.
[1] Le botaniste allemand Leonhardt Rauwolf (1583) en collecta des spécimens lorsqu’il visita la Turquie en 1573.
[2] L’Orto Botanico de Padoue fut créé en 1545.
[3] D’après Morren (1842), l’hyacinthe ferrugineuse de Virgile serait le lis martagon.
[4] La plante avait été envoyée à Charles de L’Écluse par Antonio Cortusi de Padoue. Mais c’est dans le livre The Herball de l’herboriste John Gerard (1597) que l’on trouve l’utilisation la plus ancienne du mot Muscari.
[5] Le mot muscari ne dérive pas de l’arabe misk sahih qui signifierait « musc véritable », comme cela vient dans plusieurs publications ; les Arabes qui connaissent très bien le vrai musc, le musc chevrotin, ne peuvent pas nommer ainsi un faux musc. Ce n’est d’ailleurs pas le nom que portent ces espèces au Proche-Orient. En Turquie, on connaît pour les muscaris le vernaculaire sumbul, d’origine arabe, le même que pour la jacinthe, et le vernaculaire muskurum, dérivant du grec moschari.
[6] Le mot hyacinthe désigne aussi depuis l’Antiquité une pierre précieuse.
[7] Il s’agit ici des Indes occidentales (l’Amérique). La tubéreuse est arrivée du Mexique en Europe au xvie siècle.
[8] Sous la forme zoumpouli, c’est d’ailleurs ce même mot qui est passé dans le grec moderne pour désigner la jacinthe d’Orient. L’origine du mot est confirmée par Nicolas Hieropais (xviiie siècle) dans son Lexique (cité par Amigues, 1992). C’est là un indice qui plaide en faveur du non-indigénat de la plante en Grèce et donne à penser que le mot hyakinthos désignait à l’origine l’espèce native Scilla bifolia L. et qu’il fut étendu à la jacinthe d’Orient après son introduction en Grèce à partir de l’Anatolie voisine, une introduction qui se fit dès l’Antiquité selon toute vraisemblance.
[9] Dans les pharmacopées arabo-islamiques, le nard indien ou nard de l’Himalaya (Valeriana jatamansi Jones) porte le même nom (sumbul hindi) ainsi que le musk rot (« racine de musc ») d’Asie centrale, Ferula sumbul (Kauffm.) Hook. f. (syn. : Ferula moschata (Reinsch) Koso-Pol. ; sembel, sunbul tîb) et d’autres plantes aromatiques.
[10] Pour les références bibliographiques concernant ces vernaculaires, voir Demirci & Ozhatay (2012) et les publications citées dans la partie de cet article consacrée aux aspects ethnobotaniques.
[11] Une fois dans l’année, en Turquie, se tient la fête des crocus, cidjem bayrami. On prépare à cette occasion le pilaf de crocus en faisant cuire les cormes avec du blé concassé (bulghur) de l’huile et du sel (Nicolas, 2009).
[12] Sous le nom de lampascioni ou lamponi, les bulbes sauvages (ou cultivés) de Leopoldia comosa sont bouillis (une ou deux fois 20 min dans de l’eau ou dans un mélange moitié eau moitié vinaigre) après récolte (pour les désamériser et les rendre plus digestes) puis mangés au naturel avec du sel et une vinaigrette en entrée ou frits avec des œufs. C’est une spécialité du centre de l’Italie (Monte Gargano), mais aussi de Grèce, de Chypre et de Turquie. Quand ils sont destinés à la conserve, les bulbes, préalablement débarrassés de leurs culots, sont ébouillantés deux fois en changeant l’eau de cuisson à chaque fois, puis confits avec de l’ail dans du vinaigre chaud et mis en bocaux pour être grignotés dans les occasions en apéritif. On peut aussi les retirer du vinaigre et les conserver dans de l’huile (Buccini, 2009).
Là où ils résident (notamment aux États-Unis), les immigrés italiens et grecs font venir ces bulbes car leur consommation prend chez eux une signification identitaire. Le Maroc en exporte régulièrement aux USA (Bellakhdar, 2020). Tous les bulbes de muscari sont consommés de la même façon. Leur amertume est due à la présence de saponines. On s’est également servi autrefois de ces bulbes comme source d’amidon pour l’apprêt des tissus.
[13] Jusqu’en 1924, la capitale de l’Empire ottoman était surtout connue sous le nom de Constantinople, l’ancienne Byzance de la période romaine ; Istanbul n’était alors que le nom de la ville intra-muros. C’est Kamal Ataturk qui imposa en 1924 Istanbul comme nom de la ville dans son ensemble.
[14] La Syrie est devenue province de l’Empire sous la dynastie des Ottomans après avoir été pendant des siècles le centre du pouvoir magnificent des Omeyyades.
[15] White (1845-1846, II : 86) rapporte avoir vu cette huile chez les parfumeurs du bazar de Constantinople, à côté d’autres huiles parfumées (santal, agalloche, œillet, jasmin, bergamote, musc, rose).
[16] Anémones, fritillaires, tulipes, coquelicots, jacinthes. Cette place occupée par la jacinthe dans les rituels de célébration du printemps s’inscrit clairement dans la continuité du hyakinthos mythique des anciens Grecs, symbole chez eux de la végétation printanière, tour à tour renaissant et disparaissant sous l’action du soleil.
[17] La gélification des sorbets à l’aide de semences mucilagineuses de Sisymbrium sophia L. ou d’Ocimum basilicum L., pratique très courante en Iran, permet une bonne dispersion à froid de ces macérats gras de fleurs de jacinthe. Voici d’ailleurs une recette moderne simple pour préparer une gelée parfumée à la jacinthe : dans un bocal à couvercle, introduire 40 g de beurre de clochettes de jacinthe, 100 g de sucre roux, le jus d’un demi citron, 100 ml d’eau et ajouter une demi-cuillerée d’agar-agar ou de mucilage végétal (un peu plus si on veut que la gelée soit épaisse) ; agiter, laisser gonfler puis mettre en pot. En utilisant des semences mucilagineuses ou de l’agar-agar, on peut aussi préparer des confitures sans cuisson. En théorie, on pourrait préparer de cette manière des confits sucrés de fleurs de jacinthe qui conserveraient leur parfum, mais ce serait alors des gelées à consommer aussitôt préparées car rapidement périssables.
[18] Ce lait parfumé à la jacinthe servant à préparer des desserts lactés est connu aussi à Alep, d’après des réfugiées syriennes que nous avons rencontrées à Rabat au cours de l’été 2021.
[19] Rappelons ici que les amandes sont riches en huile grasse. Les réduire en poudre grossière est une manière d’augmenter le contact de l’huile qu’elles contiennent avec les fleurs de jacinthe.
[20] Cette espèce ne peut être le glaïeul d’Abyssinie, également dénommé lis d’Abyssinie (Gladiolus murielae Kelway), une plante à grandes fleurs blanches très parfumées, qui ne fut introduite d’Afrique orientale, d’abord au Royaume Uni, qu’en 1920 par James Kelway.
[21] En France, au xvie siècle, deux livres de ce type ont été publiés. Le premier est celui de Benoist Rigaud & Jean Saugrain (1558), La pratique pour faire toutes confitures, condiments, distillations d’eaux odoriférantes & plusieurs autres recettes très utiles, édité chez Benoist Rigaud Lib., 1558, republié sous le titre La manière de faire toutes confitures, avec la vertu et propriété du vinaigre, Paris, Lib. Jean Bonfons, vers 1560, réédité par Klincksieck, 1992, 206 p. Le second est celui de Nostradamus, Excellent et moult utile opuscule à touts nécessaire, qui désirent avoir cognoissance de plusieurs exquises recettes divisé en deux parties, publié en 1555, Lyon, Ed. Antoine Volant, 228 p. Cet opuscule comporte deux parties : I – Fardemens & senteurs pour illustrer & embellir la face, qui donne des recettes de parfums, de savons, de fards et d’onguents divers ; II – La façon & manière de faire toutes confitures. Une lecture analytique de la deuxième partie de ce livre a été donnée par Deveau (2006).
[22] Nostradamus (1555) et Benoist Rigaud & Jean Saugrain (1558) déjà cités supra dans la note 21 ; Olivier de Serres, seigneur du Pradel, produit Théâtre d’agriculture et mesnage des champs (1660), Nicolas de Bonnefons (1651) publie Le jardinier françois (1651) suivi par Les délices de la campagne (1662) ; François Massaliot fait paraître Le confiturier royal, écrit en 1776. Tous ces livres consacrent de nombreuses pages aux confitures, celui de Rigaud & Saugrain et celui de Massaliot traitant aussi de vins parfumés, d’eaux odoriférantes et de savonnettes.
[23] Nous n’avons toutefois trouvé dans la littérature consultée aucune mention affirmant explicitement que la jacinthe ait fait partie des fleurs que l’industrie confisière a utilisées. Elle est seulement donnée comme cultivée dans la région grassoise.
[24] Beaucoup de fleurs sont comestibles et sont utilisées crues pour leur saveur (notamment pensée, primevère, pivoine, souci, dahlia, chrysanthème, bégonia, safran, capucine, robinier, courgette, magnolia) ou leur arôme (tulipe, jonquille vraie, œillet, violette, giroflée).
[25] La technique moderne de fabrication des fleurs cristallisées est la suivante : les fleurs sont badigeonnées de blanc d’œuf battu en mousse à l’aide d’un pinceau, en écartant les pétales, puis saupoudrées de semoule de sucre. On les abandonne alors au séchage à l’air libre, le temps qu’il faut, en les disposant bien séparées les unes des autres sur une feuille de papier ciré ; on peut aussi les introduire quelques minutes dans un four électrique éteint mais encore chaud. Ces fleurs cristallisées peuvent se conserver très longtemps dans des boîtes en fer si elles ont été convenablement déshydratées. C’est cette technique qui est utilisée pour les fleurs de la violette et de l’agastache. Le procédé industriel consiste à mélanger les fleurs à du sucre candi puis à les laisser baigner 12 h dans une candissoire chargée de sirop.
[26] Les simples sont des produits végétaux, animaux ou minéraux utilisés dans les soins.
[27] Ces deux exemples ne sont peut-être pas les seuls, mais ils nous suffisent pour l’usage que nous voulons en faire à des fins de démonstration.
[28] La technique de l’enfleurage est connue depuis l’Antiquité. Grecs, Perses et Arabes l’ont utilisée pour préparer des onguents et des huiles parfumées en faisant absorber les principes odorants des fleurs par des matières grasses animales et végétales. Les Arabes ont beaucoup employé à cette fin l’huile de ben (Moringa oleifera Lam.). En 1928, la firme allemande IG Farben a mis au point une technique d’enfleurage à sec dans laquelle les principes odorants sont recueillis non plus sur matières grasses mais sur charbon végétal et gel de silice, d’où ils seront ensuite extraits à l’éther.
[29] Dans ces huiles essentielles reconstituées par synthèse, les terpinéols et leurs dérivés entrent pour une grande part.
[30] On nous a cependant rapporté, pour la région d’Alep (témoignage de réfugiées syriennes), que le bulbe cuit a été consommé autrefois en situation de nécessité. L’information demande toutefois à être confirmée car, de l’avis général prévalant dans les pays voisins, cette consommation est dangereuse. Il est donc possible qu’il y a eu confusion avec une autre plante à bulbe, peut-être un muscari qui partage avec la jacinthe le même vernaculaire arabe. Il ne faut cependant pas exclure que la consommation du bulbe ait été rendue possible par la mise au point d’un procédé élémentaire de détoxication. C’est ce qui s’est passé aux Pays-Bas avec les tulipes. Pendant la dernière guerre, en période de disette, lorsque la pomme de terre venait à manquer, on a mangé les bulbes et les pétales de toutes les variétés de tulipe. On débarrassait le bulbe de son cœur jaune, qui est la partie la plus toxique, avant de le cuire dans de l’eau vinaigrée. Ces bulbes ainsi détoxiqués étaient consommés au naturel ou séchés et moulus pour en tirer une farine servant à faire du pain ou de la soupe.
[31] John Gerard (1597) rapportait déjà que la consommation de la jacinthe fait gonfler la tête du bétail avant de le tuer.
[32] Nous ne considérons naturellement pas ici les usages non alimentaires, et plutôt modernes, utilisant l’huile essentielle et la concrète de la fleur de jacinthe ou ses macérats huileux.
[33] Voir à ce sujet Ouerfelli (2008).
[34] Les archives commerciales ne mentionnent, pour cette catégorie de marchandises, que l’importation de salep et de bulbes et tubercules sauvages de Turquie, une importation qui s’est d’ailleurs maintenue de nos jours. Le Journal officiel des communautés européennes, L 86, 41e année, du 20 mars 1998, mentionne dans la liste des produits autorisés à l’importation de Turquie ces bulbes et tubercules, en précisant : « Oignons sauvages du genre Muscari comosum ». En revanche, des fabrications de ce type existaient en Europe. Nous avons vu précédemment qu’un pharmacien de Vienne, déjà à l’époque de Charles de L’Écluse, commercialisait un confit de Tulipe.
[35] Cette spécialité porte le nom de lampascioni : nous en avons parlé supra. Ce sont des bulbes de divers muscaris préparés en conserve. Nous avons également évoqué au début de cette étude la question de la polyvalence du vernaculaire « jacinthe » qui crée une certaine ambiguïté.
[36] C’est vrai pour les fabrications domestiques et encore plus pour les productions industrielles. Le chef et chroniqueur gastronomique Daniel Zenner affirme dans son livre Gastronomie et plantes des jardins (2012) avoir réussi à produire des fleurs cristallisées mais sans nous préciser si celles-ci ont gardé leur arôme et leur couleur. En ce qui nous concerne en tout cas, nous n’y sommes pas parvenu malgré tous nos efforts et les différents aménagements que nous avons apportés au procédé de base.
[37] Les macérats huileux ou gras de fleurs de jacinthe peuvent être chauffés modérément et rapidement sans perdre tout leur arôme, mais ces préparations restent quand même très fragiles et ne peuvent servir qu’en économie domestique.
[38] Depuis quelques années toutefois, la pharmacologie moderne s’intéresse aux alcaloïdes contenus dans le bulbe qui semblent présenter une réelle activité anticancéreuse.
Bibliographie
Abbasi M. & Fritsch R.M., 2008. Wild Allium species used as food and folk medicine in Iran. Conference paper, First Kazbegi workshop on Botany, taxonomy and phytochemistry of wild Allium L. species of the Caucasus and Central Asia, Kazbegi, Georgia, juin 2007, Proceedings : 25-31.
Aberoumand A., 2008. Comparison of protein values from seven wild edible plants of Iran. African Journal of Food Science 2 (6) : 73-76.
Al-Antaqi (Daoud), s.d. Tadkirat, texte arabe, 3 volumes. Ed. Matba’at Al-Maymaniya, Le Caire, 630 p.
Al-Baghdadi (Muhammad ben al-Hasan b. Muhamad b. al-Karim), 1935. Kitâb al-Tabîkh (texte arabe). Imprimerie Oum Rabi’în, Mossoul (Iraq), 88 p.
Al-Biruni (Abû Rayhan), 1973. Kitâb al-saydana fi al-tibb, texte arabe traduit en anglais et annoté par Hakim Mohamed Said. Ed. Hamdard National Foundation, Karachi, 376 p.
Altundağ E. & Ozturk M., 2011. Ethnomedicinal studies on the plant ressources of East Anatolia (Turkey). Procedia of the Society of Behaviour Science 19 : 756-777.
Amigues S., 1992. Hyakinthos fleur mythique et plantes réelles. Revue des études grecques 105 (500-501) : 19-36.
Amiri M.S. & Joharchi M.R., 2016. Ethnobotanical knowledge of Apiaceae family in Iran: a review. Avicenna Journal of Phytomedecine 6 (6) : 621-635.
Asano N., Kato A., Miyauchi M., Kizu H., Kameda Y., Watson A.A., Nash R.J. & Fleet G.W.J., 1998. Nitrogen-Containing Furanose and Pyranose Analogues from Hyacinthus orientalis. Journal of Natural Products 61 (5) : 625-628.
Baser K.H.C., Honda G. & Miki W., 1986. Herb drugs and herbalists in Turkey. Studia Culturae Islamicae 27, 296 p.
Baudequin Maisonneuve S., 1996. Présence des fleurs en pays grassois. Recherches régionales – Alpes maritimes et contrées limitrophes 37e année (4) : 42-51.
Beasley H., 1853. The Druggist’s general receipt book. Philadelphia, Lindsay & Blakiston, Philadelphia, 472 p.
Bellakhdar J., 2020, La pharmacopée marocaine traditionnelle. Editions Le Fennec, Casablanca. 2 volumes, 2e édition, 1118 p.
Bertrand C.-F., 1809. Le parfumeur impérial. Brunot Labbe libraire, Paris, 404 p.
Bourcier L., 2017. Confiserie Joseph Nègre. Centre de recherches et d’études de la boulangerie et de ses compagnonnages, https://levainbio.com/cb/crebesc/confiserie-joseph-negre/
Buccini A.F., 2009. The bitter – and flatulent – aphrodisiac: synchrony and diachrony of the culinary use of Muscari comosum in Greece and Italy. In S.R. Friedland (ed), Végétables, Proceedings of the Oxford Symposium on foods and cookery, Prospect Books, London : 46-55.
Çakır E.A., 2017. Geophytes of Iğdir (East Anatolia) and their economic potentialities as ornamental plant. Eurasian Journal of Forest Science 5 (1) : 48-56.
Collectif, 1653. Antidotario napolitano di nuouo riformato, e corretto dall’almo Collegio de Spetiali, etc. Annoté par Giuseppe Donzelli, Collegio degli Speziali, Naples (1re édition 1642), 309 p.
De Amicis E., 1879. Costantinopoli, Fratelli Treve, Milan, 9e éd., ouvrage traduit en français par J. Colomb sous le titre Constantinople, Librairie Hachette, Paris, 1883, 452 p.
Dejean M., 1764. Traité des odeurs, suite du traité de la distillation. Editeurs : Nyon, Paris et Saugrain, Paris, 528 pp.
Demirci S. & Ozhatay N., 2012. Local names of some plants in Andirin, Kahramanmaraş. Istanbul Ecz. Fak. Derg. / Journal of the Faculty of Pharmacy of Istanbul 42 (1) : 33-42.
Demirci S. & Eroğlu Ozkan E., 2017. The ethnobotanical uses of Hyacinthaceae species growing in Turkey and a review of pharmacological activities. Indian Journal of Traditional Knowledge 16 (2) : 243-250.
Descotes J. (ed), 1996. Human Toxicology. Ed. Elsevier Science, 839 p.
Deveau J.-M., 2006. Le Traité des confitures de Nostradamus (publié en 1555), Ed. Être et Connaître, La Rochelle, 158 p.
Dictionnaire de L’Académie française, 1932-1935. 8th edition, article Hyacinthe.
Doerflinger F., 1989. The hyacinth story. Adsurgens, the journal of Wycliffe Hall Botanical Gardens, County Durham, England, 1 (1) : 8-13.
Dogan Y., Ugulu I. & Durkan N., 2013. Wild edible plants sold in the local markets of Izmir, Turkey. Pakistan Journal of Botany 45 (s1) : 177-184.
Ertug F., 2000. An ethnobotanical study in central Anatolia (Turkey). Economic Botany 54 (2) : 155-182.
Ertug-Yaras F., 1997. An ethnoarchaeological study of subsistence and plant gathering in Central Anatolia. Ph.D. thesis, Washington University, St. Louis.
Farahmand H. & Farzad N., 2015. Environmental and anthropogenic pressures on geophytes of Iran and the possible protection strategies: a review, International Journal of Horticultural Science and Technology 2 (2) : 111-132.
Gay J.-P.J., 1846. Pharmacopée de Montpellier ou traité spécial de pharmacie, vol. 2. Ed. J.-B. Baillère, Paris, 851 p.
Gerard J., 1597. The Herball or Generall Historie of Plantes (1st ed.). John Norton, London, 1492 p.
Ghorbani A., Kuppers M., Mossadegh M. & Bussmann R.W., 2007. Wild edible plants of Turkmen Sahra area (NE of Iran). International medicinal and aromatic plants conference on culinary herbs, at Antalya, Turkey, 29 avril-4 mai 2007.
Giambattista della Porta, 1608. De Distillatione libri IX. Rome, 154 p., édité en français sous Jean-Baptiste Porta, Des Distillations, Lazare Zetzner libraire, Strasbourg,1609, 176 p.
Godins de Souhesmes G. (des), 1891, Guide de Constantinople et ses environs. Zellich et fils, Istanbul, 282 p.
Godins de Souhesmes G. (des), 1894. Au pays des Osmanlis. Victor Havard éditeur, Paris, 400 p.
Godins de Souhesmes G. (des), 1896. Turcs et levantins. Victor-Havard éditeur, Paris, 382 p.
Guenther E., 1949. The essentials oils, 6 volumes. Van Nostrand co., New York, 427 p. + 852 p. + 777 p. + 752 p. + 507 p. + 481 p.
Hieropais N., 1939. Lexique. Anecdota Atheniensia (Liège) 2 : 393-417.
Hooper D. & Field H., 1937. Useful plants ands drugs of Iran and Iraq. Field Museum of Natural History, Botanical series, Chicago (USA), IX (3) : 1-241.
Hosseini S.H., Bibak H., Ghara A.R., Sahebkar A. & Shakeri A., 2021. Ethnobotany of the medicinal plants used by the ethnic communities of Kerman province, Southeast Iran. Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine 17, 31 : 1-36.
Hryszko R., 2018. Confiseries et diplomatie dans les colonies de la république de Gênes sur la mer Noire à la fin du Moyen Âge. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego Prace Historyczne 145 (3) : 505-515.
Hryszko R., 2021. Le radici medievali della confetteria italiana, http://hdl.handle.net/11089/37994
Hryszko R., 2021. Échange de courriers Bellakhdar/Hryszko en date du 14 septembre 2021.
Karaköse M., Polat R., Rahman M.O. & Çakilcioğlu U., 2018. Traditional honey production and bee flora of Espiye, Turkey. Bangladesh Journal of Plant Taxonomy 25 (1) : 79-91.
Karaman S. & Kocabas Y.Z., 2001. Traditional medicinal plants of K.Maras, Turkey. Science 1 (3) : 125-128.
Kargioğlu M., Cenkci S., Serteser A. & Evliyaoğlu N., 2008. An ethnobotanical survey of Inner-West Anatolia, Turkey. Human Ecology 36 (5) : 63-777.
Kargioğlu, M., Cenkci S., Serteser A., Konuk M. & Vural G., 2010. Traditional uses of wild plants in the Middle Aegean region of Turkey. Human Ecology 38 : 429-450.
Knight A.P., 2007. A guide to poisonous house and garden plants, Teton Newmedia, Jackson, Wyoming, USA, 278 p.
Kociszewska E., 2020. Display of sugar sculpture and the collection of antiquities in late Renaissance Venice. Renaissance Quarterly 73 : 441-488.
Kocyigit, M. & Ozhatay N., 2009. The wild edible and miscellaneous useful plants in Yalova Province (Northwest Turkey). Journal of the Faculty of Pharmacy of Istanbul 40 : 19-29.
Lady Craven E., 1789. A journey through the Crimea and Constantinople. G.G.J. & J. Robinson, Pater-Noster Row, London, 328 p.
Lamy G., 2015. Le jardin du Roi à Trianon de 1688 à nos jours : de la mémoire à l’héritage, Bulletin du Centre de recherche du château de Versailles [en ligne], articles et études, mis en ligne le 14 octobre 2015, http://journals.openedition.org /crcv/13374
Lyle-Kalas E., 1974. Food from the fields, edible wild plants of Aegean Turkey. Birlik Matbaası, Bornova, Izmir, 147 p.
Loudon J.C., 1822. The Encyclopedia of gardening. Longman & consort, London, 1469 p.
Maistral F.-L., 1770. Abrégé de matière médicale, à l’usage des chirurgiens de la Marine. R. Malassis, Brest, 2 vol., 450 p. + 428 p.
Merad-Chiali R., 1973. Contribution à la connaissance de la pharmacopée traditionnelle algérienne (les éventaires du Grand Alger). Thèse de doctorat d’État en pharmacie, Institut des sciences médicales d’Alger, 441 p.
Morren C., 1842. Histoire littéraire et scientifique des lys et fritillaires tulipes, jacinthes, narcisses. Librairie étrangère (chez Muquart), Bruxelles, 68 p.
Mulholland D.A., Schwikkard S.L. & Crouch N.R., 2013. The chemistry and biological activity of the Hyacinthaceae. Natural Products Reports 30 : 1165-1210.
Nasrallah N., 2007. Annals of the caliphs’ kitchens. Leiden/Boston, Editions Brill, 2010, 908 p.
Nasrallah N., 2017. Treasure trove of benefits and variety at the table: a fourteenth century Egyptian cookbook. Editions Brill, Leyde, 704 p.
Nicolas M., 1982. Un électuaire de jouvence et une fête de printemps en Turquie. In Le Cuisinier et le Philosophe (Mélanges Maxime Rodinson), Maisonneuve et Larose, Paris : 71-80.
Nicolas, M., 1991. Quelques aromates ou l’ornement des cuisines en Turquie. Turcica XXI-XXIII (Mélanges Irène Mélikoff), Peeters, Louvain : 591-605.
Nicolas, M., 1992. Les Fêtes de printemps. Varia Turcica XIX (Mélanges Louis Bazin), L’Harmattan, Paris : 143-147.
Nicolas M., 2009. La flore de Turquie, au sujet de quelques traditions, rites et croyances. Osmanlı Bilimi Araştırmaları XI (1-2) : 65-83.
Ouerfelli M., 2008. Le sucre. Production, commercialisation et usage dans la Mediterrannée médiévale. Brill, Leiden–Boston, 809 p.
Ozbucak T.B., Kutbay H.G. & Akcin O.E., 2006. The contribution of wild edible plants to human nutrition in the Black Sea region of Turkey. Ethnobotanical Leaflets 10 : 98-103.
Paiman M.A.S., 2018. Translating arab cuisine into english: 101 recipes. University of Massachusetts Amherst, Masters Theses, 372 p.
Pedro de Castro, 1651. De Febre maligna. Verone, 256 p.
Perrier-Robert A., 1921. Journal des gourmands, confiserie, https://www.secrets-gourmands.fr/journal-des-gourmands-1/janvier-2021-confiserie
Perry Ch., 2005. A Baghdad cookery book. Prospect Books, 127 p.
Perry Ch., 2020. Scents and flavors, a Syrian cookbook. New York University Press, 194 p.
Pieroni A., Zahir H., Amin H.I.M. & Soukand R., 2019. Where tulips and crocuses are popular food snacks: Kurdish traditional foraging reveals traces of mobile pastoralism in Southern Iraqi Kurdistan. Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine 15 (59) : 1-14.
Pinar S.M., Fidan M. & Eroğlu H., 2018. Muscari botryoides (L.) Mill.: a new record for the family Asparagaceae from Turkey. Turkish Journal of Agricultural Research 5 (2) : 116-119.
Pitchon V., 2020. Luxe (taraf) et raffinement (arf) à la table abbasside. Archimède : archéologie et histoire ancienne, UMR7044 – Archimède : 327-338.
Plouvier L., 1993. L’électuaire, un médicament plusieurs fois millénaire. Scientiarum Historia 19 (2) : 97-112.
Plouvier L., 2021. Échange de courriers Bellakhdar/Plouvier en date du 24 septembre 2021.
Rauwolf L., 1583. Aigentliche beschreibung der Raisz, so er vor diser zeit gegen Auffgang inn die Morgenländer, fürnemlich Syriam, Judaeam, Arabiam, Mesopotamiam, Babyloniam, Assyriam, Armeniam u.s.w. nicht ohne geringe mühe unnd grosse Gefahr selbs vollbracht, Ed. Getruckt zu Laugingen: Durch Leonhart Reinmichel, in verlegung Georgen Willers, 487 p.
Saklani A., Navneet & Bhandari B.S., 2020. Ethnomedicinal Plant Use and Practice in Traditional Medicine. IGI Global USA, 380 p.
Saint-Simon M.H. (de), 1768. Des jacinthes, de leur anatomie, reproduction et culture. Amsterdam, 164 p.
Servantie A., 2002. Le Voyage à Istambul ; voyage à la ville aux mille et un noms : Byzance, Constantinople, Istambul. Ed. Complexe, Bruxelles, 750 p.
Sweertius E., 1612. Florilegium. Frankfurt a. Main, Erasmus Kempffer, 40 p. + 65 pl. + 42 pl.
Teyssonneyre S., 2021. Jacinthe, https://www.linkedin.com/pulse/jacinthe-sandrine-teyssonneyre/?originalSubdomain=fr
Théophraste (texte établi et traduit par S. Amigues), Théophraste, recherches sur les plantes. Paris, Les Belles Lettres (5 tomes : 1, livres I-II, 1988, 146 p. ; II, livres III-IV, 1989, 306 p. ; III, livres V-VI, 1993, 212 p. ; IV, livres VII-VIII, 2003, 238 p. ; V, livre IX, 2006, 400 p.
Tousey F., 1891. How to make candy? A complete hand book for making all kinds of candy, ice cream, syrups, eesences, etc. New York, Franck Tousey publisher, New York, 60 p.
Voorhelm G., 1752. Traité sur la jacinte. Imprimerie C.H. Bohn, Harlem, 127 p.
White Ch., 1845-1846. Three years in Constantinople, 3 vol. Henri Colburn Publisher, London, 338 p. + 372 p. + 367 p.
Wikipedia – Iranian cuisine.
Yeşil Y., Çelik M. & Yılmaz B., 2019. Wild edible plants in Yeşilli (Mardin-Turkey), a multicultural area, Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine 15 (1) : 1-19.
Yucel, E., Guney F. &.Sengun E.Y., 2010. The wild plants consumed as a food in Mihaliccik district (Eskisehir/Turkey) and consumption forms of these plants. Biological Diversity and Conservation 3 (3) : 158-175.
Zenner D., 2012. Gastronomie et plantes des jardins. I.D. L’édition, Bernardswiller (France), 128 p.